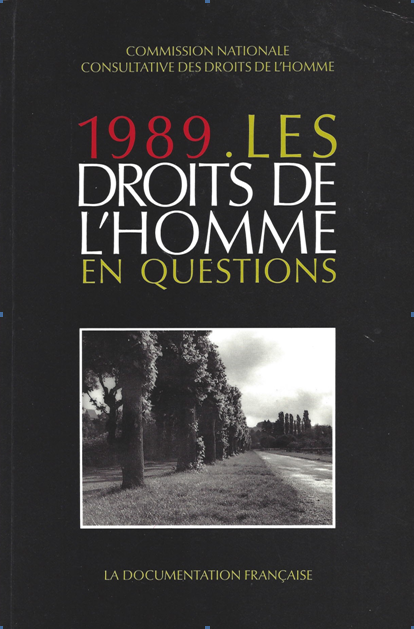Les livres
LA LAÏCITE
FRANCAISE
I : Principes et
encadrement juridique
Gérard FELLOUS
Préface de
Jean-Paul DELEVOYE
(4ème. de couverture)
Produit d’une construction historique, sociologique et politique, la laïcité est fondée en France, sur des principes indivisibles. La liberté religieuse, c’est-à-dire les convictions intimes en une transcendance, tout comme le respect de la non-croyance, constitue l’un de ces principes intangibles
Le corpus juridique qui encadre l’expression publique de tous les cultes dans la République française est riche et souvent ignoré ou méconnu. De plus, ces textes de droit sont souvent remis en question, réinterprétés, ou « accommodés» dans des tentatives révisionnistes. Nous les détaillons dans ce premier opus. Un second, publié par ailleurs détaille les positions des protagonistes français de la laïcité, au cours de deux dernières décennies, à savoir les cultes religieux et les familles politiques.
(Photo)
Après avoir été Secrétaire général de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (1986-2007) auprès de neuf Premier ministre, Gérard Fellous est expert et consultant en matière de droits de l’homme près des Nations unies, de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe et de l’Organisation internationale de la francophonie.
A Elisa
DEPOT SGDL n° 2012-07-0060
Sommaire
Préface : Jean-Paul DELEVOYE, Président du CESE
Introduction :
Première partie : Les normes juridiques de la laïcité
1 : Les principes juridiques fondamentaux
- Quatre principes
- Constitutionnalité
- Communautarisme
- Universalité
2 : Les fondements législatifs généraux
–En droit international
-Textes européens
–En droit interne :
- L’encadrement législatif général
-La mise en œuvre juridique dans les services publics
- Les chartes
- Agents du privé en mission de service public
- L’école publique
-L’enseignement supérieur
Les travaux parlementaires
- Résolutions
-Propositions de loi
3 : L’exercice du culte
–L’espace de l’expression religieuse
Espaces publics
-Edifices du culte
-Lieux d’inhumation
-Manifestations extérieures
Espaces privés
–Statut personnel
–Les entreprises
–La finance islamique
–L’incarnation d’une pensée religieuse
–Les ministres du culte :
–Les aumôneries
–Les prescriptions et rites
–Régimes alimentaires
–Abattage rituel
Dans les services publics
Dans le système de santé
Dans l’espace public
–Le temps de l’expression religieuse
–Repos hebdomadaire ;
-- Jours fériés
--Absentéisme
4: Une construction historique, sociologique et philosophique
–Une histoire longue et conflictuelle
–Evolutions sociologiques
–Des questionnements de philosophie politique
5 : Les exceptions au droit commun de la laïcité
- Régime concordataire dérogatoire d’Alsace-Moselle
- Régimes des départements et collectivités d’Outre-mer
- Mesures diplomatiques: Accords avec le Vatican
- L’école privée privilégiée (loi Carle)
- La frontière grise entre cultuel et culturel
Préface
Jean-Paul DELEVOYE,
Président du Conseil Economique, Social
et Environnemental.
Animée par des tensions de plus en plus fortes dans les rapports humains et une violence sourde contre le système, notre société traverse une période de profonde remise en cause des règles qui ont longtemps fondé sa vie collective : des discriminations ethniques au différentialisme d’assiette, de la lutte des classes à la lutte des places, se développe au détriment de notre « vivre ensemble » la tentation du repli sur soi et du chacun pour soi. C’est pourquoi , ces dernières années, j’ai voulu attirer l’attention des responsables politiques et des medias sur une France en état de burn out.
Les espérances collectives sont en panne : L’espérance collectiviste, après la chute du mur de Berlin ; l’espérance libérale avec la crise financière déclenchée par la faillite de la banque Lehman Brothers ; les espérances religieuses minées par les intégrismes ; les avancées scientifiques ressenties comme étant porteuses de risques plutôt que d’épanouissement et de progrès…Il en est de même des pratiques politiques ressenties davantage comme des stratégies de conquête ou de préservation du pouvoir que d’instruments de promotion d’un projet de société.
Dans le même temps, la survie au quotidien devient la préoccupation prioritaire pour un nombre croissant de nos concitoyens, limitant ainsi leurs perspectives. Ainsi, interrogés sur leur actuel état d’esprit, les Français signalent aux trois premières places de leurs sentiments ressentis: la lassitude, la défiance et la morosité.
Cette difficulté que rencontrent nos concitoyens à ouvrir de nouvelles espérances individuelles et collectives laisse le champ libre à tous ceux qui veulent exploiter les peurs et cultiver les humiliations.
Dans leur for intérieur, les croyants déclarent avoir besoin de l’apport spirituel des religions pour défendre avec conviction le respect de la dignité humaine, pour témoigner du respect de l’Autre et d’une conception du « faire société », pour apporter un questionnement sur la finalité de leur existence et de leurs actions, pour transmettre un héritage fondé sur une histoire séculaire et des valeurs , là où trop souvent, la société est déchirée par des intérêts égoïstes.
Tout autant que la non-croyance, la croyance religieuse traduit dès lors moins l’appartenance à un groupe que l’expression d’une identité personnelle sous influences multiples. Cette archipellisation de la société est un défi pour toutes les politiques publiques et toutes nos institutions, au premier rang desquelles cette laïcité à laquelle nous sommes tous très attachés.
La République a besoin du cadre politique et juridique de la laïcité pour y parvenir dans le respect des différences, des croyances et des non-croyances de chacun. Si la mise en œuvre de ce cadre qu’est la laïcité fait souvent débat, j’en appelle à ne pas faire l’impasse sur la nécessité de défendre en permanence les valeurs qui la portent car, en Démocratie, les valeurs priment.
La différence avec la situation de 1905, qui vit la promulgation de la loi sur la séparation entre les Eglises et l’Etat, ne réside probablement pas dans la recomposition du paysage religieux contemporain, avec le passage d’une religion dominante avec plusieurs cultes minoritaires, vers un paysage plus diversifié. Ma conviction est que le défi réside aujourd’hui dans la capacité pour les responsables de la cité de gouverner en prenant en compte les comportements de citoyens de moins en moins enclins à se plier aux règles collectives, qu’elles soient morales ou juridiques, pour adopter des modes de vie, des appartenances et des influences de plus en plus hétérogènes.
Cette fragilisation des acteurs de régulation devant ces nouveaux enjeux peut hélas conduire soit vers un aveu d’impuissance, soit vers une dangereuse surenchère. Il convient d’éviter ces écueils et de renouveler la réflexion sur cette problématique majeure.
Jean-Paul DELEVOYE
Introduction
« Liberté- Égalité- Fraternité – Laïcité », la devise de la République française est-elle ainsi complétée, en ce début du XXIe siècle, aux frontons des mairies, des écoles et des édifices publics, marquant une étape nouvelle, plus de cent ans après la loi qui consacra la séparation des Églises et de l’État?
C’est ce qui apparaît, en ce 22 février 2010, tout au moins sur la façade de l’Hôtel de ville de Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire), après qu’en janvier 2004, tous les lieux publics et édifices municipaux de la ville d’Étampes (Ile-de-France) eussent été, eux aussi, placés sous cette nouvelle devise républicaine. En 2012 au fronton des écoles de la ville de Sciez (Haute-Savoie) est gravé : « Ecole publique laïque, Liberté, Egalité, Fraternité ».
Il est vrai que ces initiatives communales firent long feu, faute d’une modification de l’article 2 (alinéa 4) de la Constitution française, dans son texte du 4 octobre 1958. Cette perspective est ouverte, le 25 janvier 2013, avec le dépôt à l’Assemblée nationale d’une proposition de loi constitutionnelle précisant que : « La devise républicaine est « Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité ».
Au cours des dernières années, des centaines de manifestations, partout sur le territoire national, ont mobilisé les citoyens dans villes et villages :
Plantations d’arbres de la laïcité –hêtres, oliviers, acacias ou chêne- de Rouen à Port-la-Nouvelle, de Peyriac-Minervois à Taizé-Aizié, de Brailles à Angers ;
Inaugurations de squares, rond-point, places et rues de la laïcité, de Paris où, le 9 décembre 2011, une place au métro Convention dans le XVe arrondissement, prend le nom de « place de la laïcité », à Périgueux ou à Garneau ;
Lâchers de colombes, comme à Château d’Aix ; fêtes populaires, comme celle organisée par l’association de quartier de Lalande (Tarn-et-Garonne) ; ou initiation œnologique en prélude à une conférence au foyer municipal de Gueugnon (Saône-et-Loire) ; banquets ou apéro-républicains, comme à Cottage- des- dunes ou à Berck ; cœur d’élèves des écoles de la République à Barbaira et Dunkerque, ou colloques savants, comme à Cahors.
Au fil de l’actualité, il s’avère bien que le cœur de la France profonde bat pour la laïcité.
Et pourtant la laïcité parait aujourd’hui menacée, sinon agressée, de plusieurs manières, par :
- L’ignorance ou la méconnaissance : En premier lieu de son substrat juridique, de ses lois, ses décrets, ses règlements qui la définissent, l’encadrent et donnent réponses à maintes questions que les citoyens et les fonctionnaires publics se posent face aux revendications religieuses et politiques pressantes, mais aussi de la part de la jeunesse ;
- Un détournement de sens ou un travestissement de définition :
–La laïcité est-elle une « auberge espagnole » dans laquelle chacun retient exclusivement ce qui lui conviendrait ? Ses principes sont-ils indivisibles ?
Dans le même temps, il semble bien que la laïcité, dont l’attachement paraît quasiment unanime dans l’opinion publique, est souvent perçue dans le plus grand flou. Le mot est affublé d’une multitude de qualificatifs qui en donnent les acceptions les plus diverses, sinon fantaisistes.
Elle fut et demeure un enjeu de société, et donc peut se trouver au cœur d’un débat politique mené démocratiquement. Alors la question est de savoir s’il faut « historiciser » la définition de la laïcité ou s’il faut retrouver son sens des origines ? S’il faut quitter l’histoire nationale pour élargir la perspective et penser la laïcité à l’échelle européenne ou mondiale, l’universaliser?
–La laïcité fait-elle l’objet de détournements idéologiques, en une sorte de relativisme religieux et culturel ?
On doit aujourd’hui constater que les religions proposent chacune des visions différentes de la laïcité, alors qu’une majorité de citoyens sont aujourd’hui non-croyants.
Ainsi, une adéquation de la laïcité aux ambitions d’une France catholique était souhaitée par le Cardinal Jean-Marie Lustiger qui, après avoir constaté que « la laïcité est une grandeur historique et culturelle », s’interrogeait : « Quelles seraient les questions nouvelles posées à la laïcité dans notre société française? Celle-ci a profondément bougé depuis la fin de la première guerre mondiale. Ces mutations ont bouleversé l’équilibre interne de la vie sociale. La République avait, dès ses débuts, donné toute leur place aux minorités religieuses : accueil du protestantisme, reconnaissance accordée aux citoyens juifs pendant la Révolution française. Mais la place du catholicisme demeurait singulière, parce que, de fait, majoritaire. La religion catholique faisait comme partie du « service public », cependant qu’elle vivait et tenait sur ses propres ressources. Or tout cet « édifice » a été profondément bouleversé tout au long du XXe siècle pour des raisons idéologiques comme pour des motifs économiques et sociaux. S’est-on rendu compte qu’un des fleuves nourriciers de la mémoire, comme de la moralité publique, était mis en question, voire détourné ? (…) De tout ce bouleversement, le catholicisme fait les frais » (séminaire de la CNCDH du 21 septembre 1995).
Les pressions nouvelles des religions auxquelles se trouve confrontée la laïcité sont également évoquées par Joseph Sitruk, alors Grand Rabbin de France (1995) qui constatait: « Tout le monde s’inquiète, à juste titre de la montée de l’intégrisme qualifié de « déformation d’une croyance religieuse », le rejetant totalement, tout comme le prosélytisme. Il s’interrogeait alors : « Comment vivre ensemble? Dans la « laïcité à la française », il conviendrait de réfléchir à une limite : l’acceptation de la différence » sans pour autant créer de ghettos communautaristes, ajoutait-il.
Le protestantisme qui fait de la laïcité une « valeur proprement théologique », en a beaucoup bénéficié. Le pasteur Michel Wagner s’interrogeait alors : Existe-t-il une description intangible de la laïcité, un modèle déposé ? Pour répondre: « La laïcité n’est ni absolument neutre, ni vraiment universelle, elle est le produit d’une histoire et d’une culture. Il y a, en Europe notamment, plusieurs types de laïcité : les modèles français, anglo-saxon, fédéral germanique, scandinave ». Quant au bouddhisme de France, il s’est fort bien accommodé du cadre juridique de la loi de 1905 en adoptant les formes d’association cultuelle et le statut de congrégation.
Ces questions posées par les religions demeureraient-elles pertinentes en ce début du XXIe siècle ?
–La laïcité peut-elle se plier à une instrumentalisation politicienne ?
On en verra des illustrations paradoxales, en particulier au cours de la campagne pour les élections présidentielles de 2012.
- Troisième menace, la non-effectivité de sa mise en œuvre :
–De multiples et fortes pressions provenant de la sphère politique et d’une partie de la société civile s’exercent pour empêcher que la laïcité soit appliquée dans sa plénitude.
Au nom d’une prétendue souplesse, ou d’une faculté d’adaptation, certains substituent aux principes de la laïcité des « accommodements », des interprétations, sensées satisfaire ceux qui voudraient s’en affranchir, au prétexte qu’il faudrait sauver une paix civile et un « vivre-ensemble » menacés.
Dès le début des années 2000, le Haut conseil à l’intégration (L’islam dans la République), se voyant investi d’une expertise en la matière dans le cadre de ses attributions sur l’immigration, tente une approche de realpolitik en estimant que « la laïcité n’est pas une notion dont le contenu se serait figé il y a un siècle: elle se nourrit des évolutions de la société, des attentes du corps social, comme des exigences de l’État de droit ».
Ainsi la question est clairement posée de savoir si c’est la laïcité qui doit être amenée à s’adapter aux définitions et aux revendications religieuses et politiques, en se modifiant, ou si ce sont les pratiques cultuelles qui doivent se conformer aux principes fondamentaux de la laïcité ?
Certains ont répondu positivement au premier terme de la question. Pour d’autres il s’agirait de tentatives « revanchardes » des religions pour effacer ou saper les acquis juridiques de la laïcité.
- Enfin, une quatrième menace résiderait dans un appel à l’universalisme voulant faire de la laïcité une exception française qui finirait par disparaitre dans la mondialisation, et se confondre avec le modèle anglo-saxon de communautarisme et d’implication des religions dans la vie publique.
Nous posons que la laïcité est une construction juridique, elle relève d’un Etat de droit, avant d’être un phénomène sociologique, philosophique ou un enjeu politique.
Si au cours des quinze dernières années, un débat sur la laïcité fit sa réapparition dans l’espace politique, ce fut à l’occasion de polémiques soulevées sur les thèmes de l’identité nationale, de la place de l’islam ou au cours des campagnes électorales de 2011-2012. Cette thématique est également apparue dans l’ensemble des pays se réclamant de ce concept, ainsi que dans les pays musulmans réveillés par « le printemps arabe », plaçant dans un nouveau contexte les rapports entre l’État, la société civile et les religions.
Des conceptions diverses ont été avancées, entrainant parfois des conséquences différentes, certaines opposées. Chacun-représentant des cultes, responsable politique- interprète la laïcité en fonction de sa situation ou de ses intérêts, de ses besoins ou de ses ambitions. De multiples applications, dans des situations concrètes, ont été improvisées. Les spécialistes eux-mêmes, juristes, politologues, sociologues, historiens, philosophes en font des analyses divergentes. Pour une part de l’opinion publique, sur- saturée médiatiquement à certains moments, la notion se brouille sous les effets d’approches extensibles, infléchies, détournées ou manipulées, certains voulant faire accroire qu’il serait urgent de repenser ou de rénover l’un des piliers de la République française.
Ces offensives contre la laïcité cacheraient-elles en réalité des manœuvres lancées pour l’affaiblir, la détourner, l’évacuer subrepticement, la faire tomber dans le discrédit ou la faire sortir de la modernité ?
Il n’en demeure pas moins que, produit d’une construction politique et d’une évolution historique, sociologique et philosophique, l’institution de la laïcité française est née d’un long cheminement. Bien que le terme ne soit apparu qu’en 1879 dans le supplément du dictionnaire « Littré » et qu’elle soit considérée comme une invention de la IIIe. République, certains la font remonter à bien plus loin: « Elle est un fait de civilisation né de mille ans d’histoire et de multiples conflits: la croisade contre les Cathares, la Saint-Barthelémie, les dragonnades, l’Édit de Nantes et sa révocation. L’attachement à la laïcité ne résulte pas d’une décadence au cours de laquelle auraient été perdues les valeurs maîtresses et notamment spirituelles mais d’un combat qui a marqué l’histoire. Notre laïcité n’est pas une laïcité par défaut: elle est le fruit d’une expérience, un compromis auquel nous tenons, fondé sur des valeurs exigeantes, sociales, humaines, profondément humaines », faisait remarquer Edgar Pisani.
C’est en 1989 que le débat politique public sur la laïcité a été relancé en France à l’occasion de l’affaire dite des « foulards islamiques », portés par de jeunes collégiennes. La question de la liberté, pour les élèves, de manifester leurs opinions ou leurs convictions religieuses par des signes est soulevée à l’intérieur des établissements scolaires publics. Le débat sur les expressions et les pratiques religieuses n’a cessé de s’étendre au-delà de l’école, dans les hôpitaux, dans l’armée, les établissements pénitentiaires, puis dans les entreprises privées, et à présent dans l’espace public de la rue.
Il y a vingt ans, c’est à propos de l’Islam que la question de la laïcité s’est posée à nouveau, à la lumière des revendications exprimées par les musulmans, cherchant leur place dans la société française, mais aussi partout en Europe ou dans des pays où ils se trouvent en position minoritaire. Dalil Boubakeur, recteur de l’Institut musulman de la Mosquée de Paris s’interrogeait déjà en 1995 : « L’une des difficultés que rencontre l’expression religieuse de l’Islam, dans notre société, réside dans le fait que cette religion se présente à la foi comme un dogme, une culture et une société », allant jusqu’à se demander: « Est-ce qu’il y a vraiment la conception d’un État laïc dans l’Islam ? ». Il constate alors que « la laïcité est reçue avec une espèce d’inquiétude dans cette séparation entre le religieux et la sphère publique. Cette inquiétude rejoint celle de la modernité ». Il concluait avec une note d’espoir : « La laïcité est peut-être une chance pour l’Islam ». Mais il serait faux d’affirmer que c’est uniquement la constitution d’un « islam de France » qui serait à l’origine du coup de projecteur donné sur la laïcité. Les autres cultes, moins mis en avant, sont également à l’origine de sa remise en question.
Déroulement de l’ouvrage.
Au commencement se trouve un rappel exhaustif des principes juridiques de la laïcité et de leurs fondements.
Se posent d’emblée trois questions :
Qu’en est-il de la constitutionnalité de la laïcité ?
Est-elle compatible avec une quelconque forme de communautarisme ?
Quelles sont les dimensions universelles de la laïcité française ?
On rappellera que celle-ci répond à un corpus juridique international, et plus particulièrement européen.
En droit français, on précisera les textes de base et en particulier la mise en œuvre de la laïcité dans les services publics.
Le débat ouvert dans l’agora, l’est aussi dans la représentation nationale, à travers diverses résolutions parlementaires et propositions de lois.
Du général au particulier, c’est-à-dire à l’exercice du culte dans une France laïque, on détaillera le réseau des lois, des décrets et des règlements qui encadre ses multiples expressions.
Construction juridique, la laïcité est également le fruit d’une construction historique, sociologique et philosophique.
Au fil du temps, des exceptions ont été imposées au droit commun de la laïcité, qu’il s’agisse des régimes en Alsace-Moselle, et dans les départements et collectivités d’Outre-mer, ou de mesures diplomatiques engagées avec le Vatican. L’école privée, en particulier religieuse, bénéficie également de mesures dérogatoires. C’est également manifestée, récemment, une confusion entre pratique religieuse et activité culturelle.
Dans une étude séparée complétant cet ouvrage, consacrée aux sciences politiques, seront détaillées les interprétations que les religions et mouvements de pensée donnent de la laïcité, avec un focus particulier sur les pressions exercées par les extrémistes religieux de tous bords.
Enfin, une seconde étude annexée montrera que dans l’arène politique la laïcité a récemment subie les plus fortes interrogations, pas seulement de la part de certains partis politiques, mais aussi dans le cadre d’un engagement politique accru des religions.
Qu’en pense l’opinion publique ? C’est à celle-ci que le dernier mot sera donné.
+ lien de rachat en ligne
POSTFACE
Jean-Michel BAYLET
Président du Parti Radical de Gauche
Ajouter quelques mots après un travail d’une ampleur et d’une qualité telles que celles de l’essai magistral ici livré par Gérard Fellous suppose, de façon paradoxale, un peu d’orgueil et beaucoup d’humilité.
L’humilité est commandée par l’excellence des réflexions qui nous sont proposées. Qu’il s’agisse des bases juridiques de notre laïcité, de la longue et conflictuelle histoire des cultes et de leurs rapports avec la puissance publique ou encore des dynamiques religieuses modernes et de leur approche par la philosophie politique, la vaste panorama dessiné par Gérard Fellous présente à la fois une vue d’ensemble très juste et des détails saisissants. Comme dans ces immenses polyptiques de la peinture flamande – souvent d’inspiration religieuse – où la description du monde et de son fragile équilibre va de pair avec la restitution d’un visage, d’un animal, d’une plante. C’est que, dans une vision laïque exigeante, il n’y a pas de petit sujet ; tout doit obéir à une harmonie globale. Après la lecture de cet ouvrage, le militant doit observer prudence et retenue, d’autant plus que l’ambition de Gérard Fellous dépasse largement les limites que son titre semblait imposer à sa réflexion.
Mais c’est aussi de notre parfaite concordance de vues que le radical de gauche que je suis peut tirer un peu d’orgueil. Aucune vanité personnelle certes mais l’orgueil collectif des radicaux qui ont inscrit la laïcité dans notre droit positif et dont l’auteur reconnaît ici qu’ils sont encore les gardiens les plus vigilants de ce principe essentiel.
C’est donc bien avec modestie et fierté tout à la fois qu’on peut apporter quelques précisions sur des faits, des évolutions, des idées sous-jacents dans le texte de Gérard Fellous.
L’Histoire n’est pas finie. Le diagnostic péremptoire et assez puéril qu’avaient entraîné la chute du mur de Berlin et l’effondrement de l’URSS, celui de la fin de l’Histoire, a été violemment démenti par les attentats du 11 septembre 2001. Beaucoup d’autres événements (à l’heure où j’écris ces lignes, les affrontements religieux en Birmanie ou aux Philippines, la canonisation socialiste d’Hugo Chavez, l’institution d’un fan-club planétaire pour le nouveau pape ou encore la suppression de la mixité dans les écoles de Gaza) ont démontré la permanence de l’Histoire, la permanence aussi de son caractère tragique, mais également son organisation autour d’une ligne de conflit, informelle, immatérielle, fluctuante, entre l’universalisme et l’identitarisme. Mais ces deux visions du monde ont été dévoyées en une caricature, celle d’un match Ben Laden vs George Bush. Quand l’universalisme se transformait en libéralisme effréné, en matérialisme sans principes, en individualisme sans foi (eh oui !) ni loi, l’identitarisme se réfugiait dans l’ethnicisme, le tribalisme et la religiosité tout en s’habillant d’un moderne costume d’Arlequin, le multiculturalisme.
Nous refusons cette vision réductrice de l’Histoire. Nous sommes tenants de valeurs universelles qui peuvent, s’il le faut, être résumées à l’autonomie du sujet, à l’égalité en droit et aux formes démocratiques de la représentation politique. Il s’agit là d’un socle insusceptible de la moindre transaction, de la moindre concession.
Car la laïcité est un principe de rigueur. Nous ne sommes ni des dogmatiques laïques, ni des intégristes armés contre les autres intégrismes. La laïcité, rappelons-le, n’est pas une pensée de combat antireligieuse, elle est la garantie de la liberté de conscience. Et c’est pourquoi elle dresse autour des institutions publiques, en particulier autour de l’école qui est la matrice de l’éveil de cette pensée libre, un rempart garantissant leur neutralité contre toutes les influences, celles des confessions bien sûr, mais aussi celles de l’argent ou de l’esprit partisan.
C’est un rempart d’airain. Il faut refuser l’adjonction de ces qualificatifs qui viendraient affaiblir cette neutralité. Nous n’avons que faire d’une laïcité modernisée, ouverte, positive. Nos principes ne vont pas au gré de l’air du temps. Ces appauvrissements recouvrent, en vérité, deux dérives également inacceptables. Pour les uns, la laïcité tolérante n’est qu’une lassitude, une résignation, quelque chose comme le plus petit dénominateur commun d’une République réduite par les assauts anti-républicains. Pour les autres, farouches adversaires de la laïcité par le passé, ce principe n’est invoqué aujourd’hui que pour fonder une volonté de discrimination. Bref, s’il faut interdire le voile, il faut aussi interdire aux extrémistes de se dissimuler sous la laïcité.
Qu’est-ce, à la fin, que la tolérance ? Dans le tableau qu’il dresse des positions politiques, G. Fellous n’oublie pas de rappeler que certains abandons du principe laïque sont venus de cette gauche qui prétendait moderniser la laïcité pour la renforcer. L’enfer philosophique étant, lui aussi, pavé de bonnes intentions, ces reculades étaient opérées au nom de la tolérance. Mais la tolérance est un moyen au service de la liberté, comme le doute méthodique et la raison discursive ; elle n’est pas une fin en soi. C’est parce qu’elle est tolérante à la liberté que la laïcité doit être intolérante à ces petites lâchetés.
A quoi rime-t-il, au moins dans une France républicaine, de juger que telle forme d’islam est plus tolérante que telle autre, que telle théocratie juive est plus estimable que sa concurrente, ou que tel pape est plus « moderne » que son prédécesseur ? A quoi correspondent, sinon à un projet d’assignation à résidence religieuse, ces statistiques faisant d’une religion la première, la deuxième ou la troisième du pays, comme s’il fallait légitimer par avance leurs empiètements sur la sphère publique ?
La République n’a pas à évaluer la prétendue tolérance des croyances aveugles, spécialement pas celle des religions qui prétendent à l’universel et s’y appliquent par leur prosélytisme.
S’il fallait exprimer une infime nuance à propos de cet ouvrage qui a conquis notre adhésion quasi-totale et dont nous remercions l’auteur, je dirais, à l’inverse de la conclusion de Gérard Fellous, que la laïcité n’a pas à être ajoutée à la devise républicaine. Ce serait la réduire. Elle est la colonne vertébrale de nos institutions et c’est elle qui éclaire les valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, elle, et elle seule, qui leur donne tout leur sens pour aujourd’hui et pour l’avenir.
Jean-Michel BAYLET
TABLE DES MATIERES
Les protagonistes de la laïcité
Au cours des deux dernières décennies,
Face aux religions et aux politiques
Chapitre 1
La laïcité face
aux religions et mouvements de pensée :
Des interprétations différentes
–Introduction
-Les poids démographiques des religions
-Nouvelles caractéristiques sociologiques
-Face à la laïcité
Des religions « partenaires » de la laïcité
Le Vatican et l’Eglise catholique française
–Au Vatican : Une laïcité réinterprétée
-De Rome vient la parole
-La liberté religieuse
-Jean-Paul II et la Loi de 1905
-Benoit XVI revisite la laïcité
-De la « laïcité positive » à la « juste laïcité »
-Face à l’islam
-Les « défis de la laïcité »
-Actions d’influence
-La supposée arrogance de la France
-La prétention d’un magister moral pour tous
-Le Vatican entre « laïcisme et fondamentalisme ».
–En France : Un héritage historique conflictuel
-L’histoire d’un ralliement
-Bon gré, malgré
-Période contemporaine
-Des solutions pragmatiques de contournement
–Les positions officielles sur :
-La loi de 1905
-La Constitution de 1958
–« Adapter la laïcité aux exigences de l’Eglise »
-La morale chrétienne
-Les relations avec le pouvoir politique
-Dialogue politique et revendications
-Les lois sur la bioéthique, et la fin de vie
-La « théorie du genre » et les orientations sexuelles
-Le « mariage pour tous »
-Descendre dans la rue
-Actions de lobbying
–Ethnocentrisme chrétien : Prière pour la France
–Relation avec l’islam.
–Aux marges de l’Eglise
Un protestantisme renouvelé
–Relations avec la laïcité
–Nouvelles caractéristiques démographiques et religieuses
–Sur la loi de 1905, une « laïcité modeste »…
–…Ou une « Laïcité d’intelligence » ?
–Relations avec la société :
-L’islam
-L’Etat affaibli
–Revendications envers l’Etat
–Relations avec le politique
Le judaïsme et la tentation communautariste
–L’apport historique de la laïcité
–Le judaïsme contemporain
-Face à l’antisémitisme
-Une place dans l’espace public
-Le concept de « communauté juive »
-Fidélité à la loi de 1905
-Une définition juive de la laïcité ?
-Positions du CRIF
-Face au communautarisme
–Relations avec les autres religions
–Relations prudentes avec l’Etat
-Revendications
-Réponses des pouvoirs publics
-Relations avec le président François Hollande
A la recherche d’un islam de France
–Les musulmans face à la laïcité
-L’islam doctrinal
-Face à la laïcité moderne
-L’islam est-il compatible avec la Démocratie ?
-Le cas de la France
-Profil socio-démographique de l’islam en France
-La pratique religieuse
-Interprétations
–Au contact de la laïcité française
-Approches individuelles
-Un communautarisme spécifique
-Laïcité et immigration
-Vers une coexistence pacifique ?
-Paroles de théologiens
-Des dissidents
–Relations avec l’Etat
-Une représentativité éclatée
-Le rôle des pouvoirs publics
-La vision du gouvernement Ayrault
-Qu’est l’UOIF ?
-Une représentativité dans l’impasse
-Après l’élection présidentielle de 2012
–Les revendications des musulmans de France
-Construction de mosquées
-Formation des cadres religieux
-Les « carrés » dans les cimetières
-L’abattage rituel
-Des actes antimusulmans
–Les réponses de l’Etat
-Une définition de la « laïcité sur mesure »
-Profanations et actes d’hostilité
-Financement public des lieux de culte
-Prières dans les rues
-Contacts avec le gouvernement Ayrault
Le bouddhisme tire profit de la laïcité
–Origines et histoire
–Profil sociologique
–Relation avec l’Etat
–Face à la laïcité
–Revendications
Le sikhisme en marge de la loi
Les pressions des extrémistes religieux
–Une terminologie délicate
–L’islamisme implanté en France
-Théoriciens et institutions islamiques
-Le Salafisme à double visage
-Le piétisme en terre de mission
-Le Salafisme Takfiri djihadiste
-La mission prosélyte du Tabligh
-Et sa version violente
-Dans l’éducation publique
-Dans les prisons
-Dissolution et expulsions
– Le Hassidisme messianique du judaïsme
–Des intégristes-traditionnalistes chrétiens
-Une doctrine
-Des groupuscules
-Dans le protestantisme : Les Eglises pentecôtistes
–Un ennemi commun, la laïcité
Des mouvements laïcs nombreux et vigilants
–Un inventaire sommaire
–Premier « appel commun »
–Constitution d’un Collectif laïque : Des demandes au président François Hollande
Chapitre 2
La laïcité dans le jeu politique
Les religions veulent faire sentir leur poids sur le politique
–Modifier les orientations politiques du pays
-Les tentatives d’influence de l’Eglise catholique
-Pressions sur la démocratie en 2012
–La « Sainte alliance des clergés »
-Ordres du jour
-Les limites du front commun
-Un Observatoire du pluralisme des cultures et des religions
-Le poids des cultes est-il réel ?
-Nation et religion
Positionnements des partis politiques
- L’Etat
- Le président Sarkozy et l’UMP revisitent la laïcité
–Le concept libéral sarkozien de la laïcité
-Théorisation de la « laïcité positive »
-Racines chrétiennes de la France et identité nationale
-Modification de la loi de 1905
-Vers l’islam, plusieurs messages
-Une attention au judaïsme et au protestantisme
-Des soutiens dérogatoires aux religions
-Réactions de soutien et critiques
–Cacophonie à l’UMP
-Un débat avorté sur l’identité nationale
-Une convention sur la laïcité polarisée sur l’islam
–Le gouvernement Fillon tente de suivre
-Réseaux d’instances de quadrillage
-Le Premier ministre ambassadeur de « La Fille ainée de l’Eglise »
-L’UMP dans l’opposition
- Le Parti radical
–Les propositions de différentes études
-La « nouvelle laïcité » du rapport Baroin
-Les constats d’atteinte à la laïcité du rapport Stasi
-Le rapport Machelon : La laïcité au service des religions
-Autres rapports et institutions
- La Front national voit la laïcité à travers son rejet de l’islam
- Le Mouvement démocratique de François Bayrou entre deux chaises
- La Parti socialiste entre retour aux sources et realpolitik
-Les soubassements de la pensée socialiste
-Une voie social-démocrate ?
-Trois approches en 2012
-Positions doctrinales du PS
-Positionnement sur des questions d’actualité
-La crèche Baby Loup
-Des revendications religieuses dans l’hôpital public
-Le bilan du quinquennat Sarkozy
- Les nuances de la Gauche
–Le Parti radical de gauche
–Le Parti de gauche
–Le Parti Europe Ecologie les Verts
La laïcité invitée dans la campagne électorale 2012
–L’Eglise catholique accroit son implication
–L’exécutif encourage le ralliement
–L’Eglise catholique s’engage clairement
–Le protestantisme suit
–Le judaïsme dans l’expectative
–Les musulmans silencieux
–Polémiques électoralistes à propos de…
-La viande halal/casher
-La « chasse » aux extrémistes islamiques
-De prétendues consignes de vote musulman
Les engagements du président François Hollande et du gouvernement
-Définition de la laïcité
-Loi de 1905
-Le communautarisme et les extrémismes
-Les droits des religions
-La Charte de la laïcité dans les services publics
-La fin de vie
-L’enseignement du fait religieux
-La loi Carle
-La collation des diplômes
-L’abattage rituel
-Modification de la Constitution
Après l’élection du président Hollande
-Rencontres avec les cultes
-Observatoire de la laïcité
-Propositions du gouvernement.
-Enseignement laïque de la morale
L’opinion publique face aux religions et à la laïcité
–La perception des religions. Sécularisation de la France
–L’appartenance et la pratique religieuses
-L’image de l’islam
–La perception de la laïcité.
Conclusion
Postface
de Jean-Michel BAYLET
président du Parti Radical de Gauche
4 eme de couverture
Trois protagonistes sont concernés par la laïcité française : la République, les cultes, et le politique : Les religions tentent de contourner le principe de séparation en investissant la décision politique ; en retour, une partie du monde politique tente d’instrumentaliser les religions. C’est ce « jeu à trois » qui est examiné dans cet ouvrage, la première partie ayant traité des principes et de l’encadrement juridique de la laïcité française.
En tout état de cause, la laïcité reste, avec la Liberté, l’Egalité et la Fraternité le quatrième pilier de la République française, fidèle aux valeurs fondatrices du Siècle des Lumières.
La particularité de cet ouvrage est qu’il sera prolongé par une actualisation régulière, au fil des débats et des évènements qui interviendront à l’avenir sur ces sujets, mise en ligne sur le web, et accessible gratuitement sur le site web de l’auteur : www.gerardfellous.com
(Photo)
Après avoir été Secrétaire général de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (1986-2007) auprès de neuf Premier ministre, Gérard Fellous est expert et consultant en matière de droits de l’homme près des Nations unies, de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe et de l’Organisation internationale de la francophonie.
+ lien de rachat en ligne
manque S27
LES DROITS DE L’HOMME AUX DEFIS DU XXI ème. SIECLE
Une universalité menacée
Sont examinés dans cet ouvrage les menaces qui pèsent, en ce début du XXI° siècle , sur l’universalité des droits de l’homme, sachant que certaines sont bien connues depuis soixante ans et perdurent , et que d’autres sont apparues plus récemment, et semblent avoir vocation à se développer dans les prochaines décennies, si l’on n’y prend pas garde.
Est traitée plus longuement l’une de ces menaces mutantes, sur laquelle commence à se développer une réflexion sous l’identification de « relativisme culturel et religieux ». Il s’agit bien d’un « virus », au sens informatique du terme, qui risque de faire exploser l’ensemble du corpus du droit international des droits de l’homme.
Le débat n’est pas seulement théorique, il est illustré concrètement par les offensives menées, aujourd’hui et sous nos yeux, dans le système onusien des droits de l’homme, particulièrement dans les travaux du Conseil des droits de l’homme, à Genève, et dans la phase de préparation de la Conférence d’examen et de suivi de la conférence mondiale sur la lutte contre le racisme et la discrimination qui s’était tenue à Durban ( Afrique du sud) en 2001. Cette Conférence, appelée Durban-2, s’est tenue, du 20 au 24 avril, à Genève, dans un climat délétère qui ont vu se reproduire les outrances et les débordements antisémites auxquels nous avions assisté il y a huit ans à Durban, particulièrement de la part du président de la République islamique d’Iran.
Les menaces qui pèsent sur ce XXI° siècle
L’universalité à l’épreuve du « relativisme culturel et religieux ».
L’ouvrage s’arrête longuement sur ce que l’on a appelé le « relativisme culturel et religieux » qui conteste radicalement l’universalité des droits de l’homme telle que proclamée par la DUDH.
Le « relativisme culturel », concept né de l’anthropologie, a fait l’objet de longs débats depuis 1947, à partir de l’idée que toutes les cultures ont la même valeur. S’il est vrai que la culture de chaque être humain est une composante identitaire importante, enfermer symboliquement l’individu dans sa communauté est réducteur et porteur de stéréotypes racistes et liberticides. Le droit à la différence et la tolérance ne peuvent être prétextes à brimer la dignité et la liberté humaines. Les violations des droits de femmes peuvent illustrer le propos.
Il est aujourd’hui admis que les particularismes culturels ne sont recevables qu’à condition qu’ils ne portent pas atteinte à « l’égale dignité » et aux droits égaux de tous les êtres humains. L’universalisme suppose chez toute personne une essence humaine qui transcende tous les particularismes, y compris culturel ou religieux. Au postulat de l’égalité des cultures répond l’égalité et la liberté des individus. En réalité le danger est que le « droit à la différence » glisse juridiquement vers une « différence des droits ».
Autre dérive induite de la défense du relativisme culturel, l’apparition d’une thèse admettant que la dignité humaine n’est pas vécue de la même manière selon que l’on est Chinois, Indien maya ou Suisse.
Il faut également évoquer le danger que les « particularismes culturels » reconnus se dressent les uns contre les autres en une sorte de choc des civilisations. Dans un souci de conciliation, certains, comme Mireille Delmas-Marty et Gérard Cohen-Jonathan suggèrent une « conception pluraliste des droits de l’homme ». Ceux-ci seraient « conçus à partir de principes directeurs communs, appliqués avec une marge nationale d’appréciation qui reconnaitrait aux Etats une sorte de droit à la différence mais à condition de ne pas descendre au-dessous d’un certain seuil de compatibilité, qui peut d’ailleurs varier selon qu’il s’agit d’une question plus consensuelle ou plus conflictuelle ». En quelque sorte des droits de l’homme à géométrie variable, laissés à l’appréciation des pires violateurs, sans le moindre contrôle international, ce qui reviendrait à la mort de la DUDH.
Depuis un demi siècle, certains gouvernements ou instances religieuses et politiques dénient l’universalité de la Déclaration- selon les thèses dites de Singapour- au prétexte qu’elle serait l’expression de la seule culture occidentale, fondée sur la primauté de l’individu, alors que d’autres sociétés, notamment asiatiques ou africaines, accordent une valeur première à l’harmonie du groupe, et que c’est à travers la protection des droits collectifs de la communauté que se réaliseraient plus surement les droits individuels de la personne. D’autres vont plus loin en assimilant la diffusion universelle des droits de l’homme à une simple variante de l’impérialisme blanc. Ce à quoi répliquait Kofi Annan, lorsqu’il était secrétaire général des Nations unies : « il n’est pas nécessaire d’expliquer ce que signifient les droits de l’homme à une mère asiatique ou à un père africain dont le fils ou la fille a été torturé ou assassiné. Ils le savent malheureusement beaucoup mieux que nous ».
Sur la scène internationale, un type de relativisme a déjà disparu avec la disparition de l’URSS et la chute du Mur de Berlin. A la Conférence mondiale qui s’est tenue à Vienne en 1993, 171 Etats se sont solennellement engagés à respecter les droits de l’homme universellement définis, comme le commande l’article 55 de la Charte des Nations unies à tous les Etats membres. La déclaration finale de Vienne rappelait solennellement que « s’il convient de ne pas perdre de vue l’importance des particularismes nationaux et régionaux, et la diversité historique culturelle et religieuse, il est du devoir des Etats, quel qu’en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales ». On relèvera de même que c’est au nom des droits de l’homme universels que s’est faite toute la décolonisation et que l’apartheid a disparu dans le sud de l’Afrique.
Les sociétés traditionnelles, le droit coutumier peuvent-ils et doivent-ils se plier à l’universalité de la DUDH ? Certains se demandaient comment la concilier avec une « cosmovision » de la vie, de la personne des peuples indigènes.
En réponse à ces questionnements la philosophe Jeanne Hersch invoquait « l’exigence fondamentale que l’on perçoit partout » , à savoir quelque chose qui est dû à l’être humain du seul fait qu’il est un être humain : un respect, un égard, un comportement qui sauvegarde ses chances de faire de lui-même celui qu’il est capable de devenir ; la reconnaissance d’une dignité qu’il revendique parce qu’il vise consciemment un futur et que sa vie trouve là un sens dont il est prêt à payer le prix. Pour Jeanne Hersch « cette universalité là parait d’autant plus importante que l’extrême diversité des modes d’expression en garantit l’authenticité ». Ou, selon la formule de René Cassin : « Il y a quelque chose dans chaque homme qui est universel ».
Il n’y aurait donc pas, en principe, d’exception culturelle pour la garantie des droits de l’homme, sauf que, en pratique, on peut lire dans la Convention contre la torture des Nations unies de 1984, en son article 1 que le terme de torture ne « s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes ». Faudrait-il alors admettre que des peines de mutilation existant dans des traditions culturelles, pourraient être admissibles ? Les juristes en débattent encore, même si la conscience universelle s’en trouve révulsée.
Concernant plus spécifiquement le « relativisme religieux », la menace est encore plus dangereuse pour l’universalité des droits de l’homme.
De nombreux gouvernements, dans le monde musulman, invoquent les textes sacrés de l’Islam pour refuser cette universalité. Les droits fondamentaux sont alors redéfinis et réinterprétés à l’aune de la Charia. Le phénomène est récent. En effet, le 10 décembre 1948 sur les 56 Etats ayant voté la DUDH, 8 se sont abstenus, parmi lesquels un seul Etat musulman, l’Arabie saoudite, alors qu’avaient voté pour, l’Afghanistan, l’Egypte, l’Iran, l’Irak, le Pakistan et la Syrie. Mais à partir de 1966, pour les deux pactes internationaux et les différents traités -particulièrement en ce qui concerne les conventions portant sur les droits des femmes, ou sur ceux des enfants-, les pays islamiques ont introduit des
« réserves » au nom de la Charia.
Le monde musulman a d’ailleurs édicté deux déclarations, concurrentes de la DUDH : une première rédigée par le Conseil Islamique pour l’Europe et adoptée en septembre 1981 sous le titre « Déclaration islamique universelle des droits de l’homme », et la seconde, bien plus importante, adoptée en aout 1990 au Caire par l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), sous le titre « Déclaration sur les droits de l’homme en Islam ». Cette dernière proclame (dernier article 25) que « la Charia est l’unique référence pour l’explication ou l’interprétation de l’un quelconque des articles contenus dans la présente Déclaration ». Soulignons que son article 22 stipule que « tout homme a le droit d’exprimer librement son opinion pourvu qu’elle ne soit pas en contradiction avec les principes de la Charia(…) Il est prohibé d’utiliser ou d’exploiter (l’information) pour porter atteinte au sacré et à la dignité des prophètes… ».
Deux Prix Nobel viennent de dénoncer le piège du « relativisme culturel et religieux ». Pour l’iranienne Shirin Ebadi, « la plupart des Etats musulmans non démocratiques érigent l’Islam en idéologie pour justifier « la barbarie » de leur régime ». Le nigérian Wole Soyinka ajoutait pour sa part : « Le relativisme culturel prétend nous inculquer le rejet des différences, mais en fait il exige de nous d’accepter la barbarie des crimes d’honneur, la dictature, les discriminations fondées sur le sexe et la race. C’est un piège ». Le français Stéphane Hessel tente une conciliation en estimant « qu’au fond dans toutes cultures du monde, dans toutes les grandes religions et dans toutes les grandes philosophies, il y a la même conception fondamentale de la dignité de la personne humaine, et c’est la raison pour laquelle un relativisme culturel est inadmissible ».
Illustrations dans les instances des Nations unie.
Et néanmoins ce « relativisme culturel et religieux » fait sous nos yeux un très inquiétant entrisme dans les différentes instances onusiennes. Quelques exemples peuvent être cités :
L’assemblée générale de l’ONU a adopté le 9 novembre 2001 le « Programme d’action pour le dialogue entre les civilisations », proposé par le président iranien Khatami dès 1988, devant parvenir à un nouveau texte international. Le président iranien proposait alors au Secrétaire général des Nations unies : « Nous devons parvenir à une définition appropriée du terrorisme qui fait une distinction entre un acte criminel aveugle et la défense légitime contre l’occupation, la violence et la répression », en citant comme exemple « l’occupation des territoires palestiniens, la judaïsation de la Palestine, le meurtre et la terreur des civils palestiniens sans défense ». Cette initiative est lancée quelques semaines après les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis. La tentative est clairement de faire reconnaître par l’ONU un « bon terrorisme », comme celui perpétré par des « bombes humaines » qualifiées de « martyrs de l’Islam ».
Autre exemple : dès la mise en place du nouveau Conseil des droits de l’homme, en juin 2006 à Genève, on entend le ministre des affaires étrangères d’Iran, déclarer que l’une des caractéristiques de l’ère nouvelle qui s’ouvre est « l’imposition de certaines valeurs culturelles que j’appellerai uni culturalistes(…) La jouissance de la liberté d’expression ne doit pas constituer un prétexte ou une plateforme pour insulter les religions et leur sainteté ».
Cette avancée du « relativisme religieux » est par ailleurs parfaitement illustrée lors des travaux préparatoires de la Conférence de suivi de la conférence contre le racisme – dite Durban 2-, qui visent à créer un nouveau délit de « diffamation des religions », spécifiquement appelé « islamophobie », assimilé à une nouvelle forme de racisme. En corollaire, il s’agira de supprimer la liberté d’opinion et d’expression en la matière.
Le terrain était préparé par l’élaboration de nouvelles normes contre le racisme visant à condamner « la diffamation des religions », en particulier de l’Islam, dans le cadre des travaux d’un Comité ad-hoc pour l’élaboration de normes complémentaires en matière de racisme. Après plusieurs rapports, la quatrième session du Conseil des droits de l’homme adoptait en mars 2007 une première résolution présentée par le Pakistan au nom de l’OCI. Rappelons que dans son rapport sur le racisme en France, le rapporteur spécial des Nations unies estimait que le principe de laïcité est discriminatoire et raciste, soulignant que l’interdiction des signes religieux à l’école publique en France relève du racisme et de l’intolérance. Il regrette que « la laïcité ait mené à la suspicion de la croyance religieuse », considérant que l’approche « séculariste dogmatique » est utilisée pour « manipuler la liberté de religion », comme le rapportait Malka Markovich dans la revue « Les temps modernes » (juillet 2007)
.
Par ailleurs, le Conseil des droits de l’homme concluait sa septième session en adoptant une résolution présentée par l’OCI, modifiant le mandat du Rapporteur spécial sur la liberté d’opinion et d’expression. Celui-ci ne devra non plus prioritairement promouvoir et protéger cette liberté fondamentale, mais traquer la diffamation des religions et limiter les libertés de la presse.
Le Comité préparatoire (PrepCom) de Durban 2 a, au cours de sa session d’octobre 2008, ouvert le débat sur la diffamation des religions, en introduisant dans le projet de déclaration finale plusieurs propositions des groupes de l’OCI, des non-alignés, d’Asie et d’Afrique. La position de l’Union européenne, alors représentée par la France, était qu’il est fondamental de faire la distinction entre d’une part la critique des religions ou des convictions et d’autre part l’incitation à la haine religieuse. Seule cette dernière devrait être interdite.
L’enjeu à la conférence contre le racisme était donc bien de substituer à l’universalité et à l’indivisibilité de la DUDH, une vision différentialiste de la lutte contre le racisme. On y remplacerait, (article 18), la lutte contre toute discrimination d’une personne à raison de sa religion – par exemple le racisme antimusulman-, par la condamnation d’une parole critique contre une religion globalement désignée – par exemple l’islamophobie- . Par amalgame, il s’agira alors de définir l’antisémitisme comme étant une forme de « diffamation envers une religion ».
La France et l’Union européenne n’étaient pas prêtes à accepter une telle dérive. Consultée par la Haut-commissaire aux droit de l’homme sur la mise en œuvre par la France de la résolution du Conseil des droits de l’homme du 27 mars 2008 sur « la lutte contre la diffamation des religions », la Commission nationale consultative des droits de l’homme a estimé qu’il ne «serait ni utile, ni souhaitable d’adopter des dispositions plus contraignantes et plus répressives quant à la liberté d’expression ». En particulier la CNCDH considère que « le délit de blasphème, qui est étranger au droit français depuis près de deux siècles, ne devrait pas être introduit dans des textes, qu’ils soient nationaux ou internationaux ». Elle estime enfin « qu’il n’est pas nécessaire d’adopter de mesures spécifiques pour répondre à (cette) résolution du Conseil des droits de l’homme, sans courir le risque de mettre en cause l’équilibre existant entre la liberté de conscience, y compris la liberté de religion, la liberté d’expression, le pluralisme religieux et la paix civile dans une société laïque ».
Ces dangers ont été écartés in extremis à la Conférence de Genève sur le racisme, grâce à la pression des pays dits occidentaux, mais le débat n’est pas clos. Il rebondira bientôt.
Certaines menaces perdurent depuis soixante ans. J’en traiterai de quelques unes :
n Tout d’abord ce que Mme. Louise Arbour a appelé le « schisme de la Guerre
froide » : il ne s’agit pas d’idéologie, mais d’un schisme juridique qui, dans le cadre des neuf grands traités internationaux qui ont offert un fondement contractuel et contraignant à la DUDH, a donné successivement prééminence aux droits civils et politiques, ou aux droits économiques, sociaux et culturels. Les Etats-Unis et les pays occidentaux avaient une préférence marquée pour les premiers, l’URSS autrefois, la Chine, Cuba et certains pays du Sud au sein du groupe dit des non-alignés pour les seconds. Un compromis s’est dégagé, qui n’est pas encore consolidé, selon lequel les populations peuvent plus facilement accéder aux droits économiques, sociaux et culturels, si elles ont bénéficié, concomitamment, de leurs droits civils et politiques.
n Le refus de ce que certains Etats, généralement dictatoriaux ou autoritaires,
appellent une « ingérence internationale dans les affaires intérieures ». Cette menace qui pèse sur les victimes des violations des droits de l’homme est née avec la DUDH et n’a toujours pas disparue, aujourd’hui par exemple à propos du Tibet.
Eleanor Roosevelt et René Cassin, à la tête de la commission chargée de rédiger le projet de texte, savaient bien que le point d’achoppement était celui de la « non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats », par ailleurs au fondement du système des Nations unies naissant. Face aux premières protestations contre la persécution des juifs, Goebbels répondait « Charbonnier est maître chez soi ».
La DUDH a établi un droit de regard, voire d’ingérence de la Communauté internationale en cas de violation des libertés. Il est battu en brèche par une forme de « réal politik » qui préfère fermer les yeux face à des Etats violateurs, en échange d’avantages diplomatiques ou économiques.
n On sait, depuis soixante ans, que la pauvreté est à la fois la cause et la
conséquence des violations des droits de l’homme, et que la DUDH a plus de mal à être mise en œuvre dans les pays du sud.
Pour certains, comme Mireille Delmas-Marty, « à l’heure de la mondialisation économique, l’universalité des droits de l’homme est plus que jamais à l’ordre du jour. Elle montre la voie, si l’on veut éviter une mondialisation hégémonique, pour inventer un droit commun réellement pluraliste » Fait aggravant, la crise financière qui se répand – y compris dans les pays émergeants- fait que les plus pauvres et les plus fragiles se retrouvent dans une situation pire que celle qu’ils connaissaient jusque là. La Haut-commissaire aux droits de l’homme a appelé à une vigilance accrue dans les mois à venir pour assurer que les programmes de développement et les filets de sécurité soient maintenus et renforcés, afin que les effets économiques et sociaux de la crise ne deviennent pas calamiteux.
Il faut noter par ailleurs que certains profitent pour séparer, et parfois opposer, les instruments dits « régionaux » de protection des droits de l’homme, au nom d’un « relativisme géographique ».
n La Déclaration de 1948 ne pouvait imaginer les progrès techniques et
scientifiques qui ont marqué la fin du XXe. Siècle et qui se développeront, mettant à l’épreuve la dignité humaine et les libertés fondamentales de manière inégale à travers le monde. Qu’il s’agisse par exemple du patrimoine génétique, de la reproduction assistée, de la fin de vie, du développement de la communication par les moyens électroniques ou des dégradations de l’environnement, la mise en conformité avec les droits de l’homme doit être universelle.
n Bien qu’aujourd’hui les principes formulés par la DUDH soient repris et
intégrés dans les constitutions et les lois de plus de 90 pays, que des mécanismes internationaux, régionaux et nationaux de promotion et de protection des droits de l’homme aient été mis en place, la majorité de la population de la planète ignore toujours qu’elle a des droits exigibles. Le préambule de la Déclaration de 1948 souligne que « la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révolte la conscience de l’humanité », reprenant du reste la formulation de la Déclaration française de 1789 :
« l’ignorance, l’oubli et le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements ». Pour tenter d’y remédier à l’avenir, la Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Madame Navi Pillay, lançait il y a quelques jours, dans le cadre de ce 60 e. anniversaire, l’Année internationale de l’apprentissage des droits de l’homme.
n Autre menace récurrente contre l’universalité de la DHDH et de ses instruments
internationaux, la non-effectivité des droits de l’homme. De la proclamation à la mise en œuvre effective il y a trop souvent un fossé, y compris dans nos pays démocratiques.
On y ajoutera les effets pervers et plus subtils des « réserves » apportées par de nombreux Etats. Ceux-ci donnent l’impression de jouer le jeu en ratifiant un texte international, mais ils utilisent de façon abusive la technique des « réserves » pour, en réalité, nationaliser le texte et revenir au traditionnel « chacun est maitre chez soi », et donc refuser l’internationalisation des normes.
Conclusion.
A la racine des valeurs fondant l’universalité des droits de l’homme, Hannah Arendt disait que c’est « l’idée d’humanité qui constitue la seule idée régulatrice en terme de droit international ».
Cette prise en compte de l’homme comme « mesure de toutes choses » trouve ses racines philosophiques dans la conscience universelle, et appartient en héritage indivis à toutes les civilisations et toutes les religions, soulignait le professeur Emmanuel Decaux. L’affirmation des droits de l’homme vaut partout et pour tous, ou elle ne vaut rien. Elle implique en effet « la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine », sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.
Ces droits innés trouvent cependant des limites, et d’abord dans le respect des droits d’autrui, voire des dérogations au nom de l’ordre public ou du devoir de vivre ensemble, sans compter d’éventuels conflits de droits. S’agit-il dès lors de « droits naturels » inviolables et sacrés, ou seulement de droits relatifs encadrés par la loi, sinon octroyés par l’Etat souverain ? Peut-on opposer le particularisme des situations et des cultures à l’universalité des valeurs ? La Déclaration universelle des droits de l’homme a répondu il y a 60 ans à ce dilemme : Avec elle, c’est le droit international positif lui-même qui consacre pleinement les droits de l’homme comme des droits égaux et inaliénables, qui doivent être protégés par un régime de droit.
La Déclaration universelle appartient à chacun des êtres humains. Elle n’appartient pas aux Etats, mais elle les oblige. Elle reste, hier comme demain, « l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations », comme l’a voulu René Cassin.
PREFACE
Boutros BOUTROS-GHALI
ancien Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
Les droits de l’Homme sont, tout à la fois, absolus et situés. C’est-à-dire qu’il faut, tout à la fois, les poser dans leur universalité et les rendre accessibles à tous, quelles que soient leur histoire, leur langue, leur culture.
Dès lors, les droits de l’Homme que nous cherchons à garantir, ne peuvent être que le résultat d’un dépassement, le produit d’un effort conscient pour retrouver notre essence commune par-delà nos clivages apparents, nos différences du moment, nos barrières idéologiques et culturelles.
Les droits de l’homme ne sont pas le plus commun dénominateur de toutes les nations, mais au contraire, ce que j’ai appelé lors de la Conférence de Vienne en 1993, « l’irréductible humain », c’est-à-dire la quintessence des valeurs par lesquelles nous affirmons, ensemble, que nous sommes une communauté humaine.
L’ouvrage de Gérard Fellous, ancien Secrétaire général de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme, est une contribution magistrale à l’étude des problèmes soulevés par la protection des droits de l’Homme. Cette étude passe en revue les différentes étapes franchies en la matière, de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 jusqu’à la Conférence de Vienne de 1993, qui a donné naissance à une nouvelle politique onusienne fondée sur l’imbrication entre droits de l’Homme et démocratie.
Le combat pour les droits de l’Homme et le combat pour la démocratie ne font qu’un. Mais il ne peut, dans le même temps, y avoir de démocratie sans une solide culture des droits de l’Homme. Car la démocratie, par plus que les droits de l’Homme, ne peuvent être l’objet d’un mimétisme conceptuel, d’un transfert institutionnel, comme on parlerait de transfert de technologie.
Les droits de l’Homme constituent, sans conteste, la meilleure des réponses possibles à la déréglementation généralisée que nous vivons. Mais ils ne peuvent demeurer un combat isolé, qui trouverait sa finalité en lui-même. Les droits de l’Homme sont devenus un tel enjeu pour l’avenir, nous avons mis en cet idéal tant d’espoirs et de rêves que nous devons dans les années qui viennent amplifier ce combat en l’élargissant résolument au combat pour la démocratie, pour le développement et pour la paix.
Le combat pour les droits de l’Homme est plus que jamais d’actualité. C’est un combat du XXIème siècle, transposé dans une perspective nouvelle. Et c’est à ce combat pour l’avenir que nous invite la lecture de l’ouvrage de Gérard Fellous.
Boutros Boutros-Ghali
Président de la Commission nationale égyptienne des droits de l’Homme
- 14 avril 2010- Les Mercredis de la Documentation Francaise.
« Les droits de l’homme sont-ils toujours universels ? » était la question posée le 14 avril 2010 au cours d’une conférence donnée par Gérard Fellous, dans le cadre des rencontres des « Mercredis de la Documentation Française » quai Voltaire à Paris. Cette présentation de son dernier ouvrage réunissait autour de Gérard Fellous, Boutros Boutros-Ghali, ancien Secrétyaire général des Nations unies, et préfacier de l’ouvrage, ainsi que Catherine Teitgen-Colly, professeur de droit à Paris I, et Henri Leclerc, président d’honneur de la Ligue des droits de l’homme française.
Les droits de l’homme sont-ils toujours universels ?
Introduction de Gérard Fellous
« Le principe même d’universalité des droits de l’homme est clairement remis en cause dans certains milieux…Aujourd’hui, les Etats ne semblent pas faire preuve de la même volonté que celle qui les animait au lendemain de la Seconde guerre mondiale pour affirmer fortement l’universalité de nos droits et de nos libertés », s’inquiétait il y a quelques mois Mme. Louise Arbour, alors Haut commissaire pour les droits de l’homme des Nations unies.
Il y a 62 ans, à Paris, place du Trocadéro, le juriste français, René Cassin, réussissait à convaincre la communauté internationale de proclamer une Déclaration « universelle » – et non pas « internationale » des droits de l’homme, comme prévu initialement.
En ce début du XXIe. Siècle, parmi les dix menaces qui pèsent sur cette universalité – dont certaines perdurent depuis l’origine – j’attire particulièrement l’attention sur le relativisme culturel et religieux qui conteste radicalement cette universalité .Or il est admis que le droit international que sont les Droits de l’homme ne saurait exister que s’il est partagé universellement.
Le relativisme culturel, concept né de l’anthropologie, a fait l’objet de longs débats depuis 1947, à partir de l’idée que toutes les cultures ont la même valeur. S’il est vrai que la culture de chaque être humain est une composante identitaire importante, enfermer symboliquement l’individu dans sa communauté est réducteur et porteur de stéréotypes racistes et liberticides. Le droit à la différence, et la tolérance, ne peuvent être prétextes à brimer la dignité et la liberté. Les violations des droits des femmes peuvent en être une illustration.
Il semble admis aujourd’hui que les particularismes culturels ne sont recevables qu’à la condition qu’ils ne portent pas atteinte à « l’égale dignité » et aux droits égaux de tous les êtres humains. Autre dérive induite de la défense du relativisme culturel, est l’apparition d’une thèse admettant que la « dignité humaine » n’est pas vécue de la même manière selon que l’on est Chinois, Indien ou Suisse. Il faut également évoquer le danger que les « particularismes culturels » reconnus se dressent les uns contre les autres, en une sorte de « choc des civilisations ».
Dans la diplomatie multilatérale est apparue, depuis un demi siècle, une contestation radicale des droits de l’homme – selon les thèses dites de Singapour- au prétexte qu’ils seraient l’expression de la seule culture occidentale – judéo-chrétienne fondée sur la primauté de l’individu, alors que d’autre sociétés , notamment asiatiques ou africaines, accordent une valeur première à l’harmonie du Groupe ; et que c’est à travers la protection des droits collectifs de la communauté , de la tribu, de la famille, que se réaliseraient plus surement les droits de l’individu. Certains s’interrogent : les sociétés traditionnelles, le droit coutumier peuvent-ils, doivent-ils se plier à l’universalité des Droits de l’Homme ? Comment les concilier avec une « cosmovision » de la vie et de la personne, des peuples indigènes ? D’autres vont plus loin en assimilant la diffusion universelle des droits de l’homme à une simple variante d’un « impérialisme blanc ».
La Chine contemporaine a fait sienne ce relativisme culturel pour étouffer – dans sa population et sur la scène internationale- toute dénonciation de ses violations massives des droits de l’homme. Pour écarter ce qu’elle appelle « toute ingérence dans ses affaires intérieures », la Chine argue de quatre types d’arguments : – son histoire et sa grande culture séculaire – ses croyances philosophiques, et plus particulièrement sa spécificité confucéenne – la politique officielle du parti communiste – et les spécificités de son droit interne. De manière constante, ce « révisionnisme insidieux » chinois dénonce la DUDH de 1948 comme purement occidentale et néo-colonialiste, alors que théoriquement, le principe du respect des Droit de l’homme est inscrit dans sa Constitution depuis 2004.
Le relativisme religieux menace tout autant l’universalité des droits de l’homme au XXIe. siècle.
De nombreux gouvernements, dans le monde musulman, invoquent les textes sacrés de l’Islam pour réfuter cette universalité – ou tout au moins pour en redéfinir les principes à l’aune de la Charia. Le phénomène est récent. En effet, le 10 décembre 1948, sur les 56 Etats ayant adopté la DUDH, 8 se sont abstenus, parmi lesquels un seul Etat musulman, l’Arabie saoudite. Les autres : l’Afghanistan, l’Egypte, l’Iran, l’Irak, le Pakistan et la Syrie avaient voté pour. Mais à partir de 1966, pour les deux Pactes internationaux et les différents traités – particulièrement ceux portant sur les femmes ou les enfants- les pays islamiques ont introduit des « réserves » nombreuses au nom de la Chariaa.
Le monde musulman a d’ailleurs édicté plusieurs déclarations concurrentes de la DUDH dont « la Déclaration sur les droits de l’homme en Islam » adoptées en 1990 au Caire par l’Organisation de la Conférence Islamique.
C’est l’Iran qui est la tête de file de cette contestation de l’universalité de la DUDH, lui substituant une universalité de la Chariaa.
Ce relativisme culturel et religieux fait un très inquiétant entrisme dans les instances des Nations unies. Je n’en donnerai ici que quelques illustrations :
** L’Assemblée générale de l’ONU adoptait en novembre 2001 un « Programme d’action pour le dialogue entre les civilisations » proposé par le président iranien Khatami qui déclarait : « Nous devons parvenir à une définition appropriée du terrorisme qui fait une distinction entre un acte criminel aveugle et la défense légitime contre l’occupation, la violence et la répression ». Il y aurait, en somme, un bon et un mauvais terrorisme.
** Autre exemple : dès la mise en place du nouveau Conseil des droits de l’homme, en juin 2006, le ministre iranien des Affaires étrangères déclare que s’ouvre une ère nouvelle pour les droits de l’homme, ajoutant : « La jouissance de la liberté d’expression ne doit pas constituer un prétexte ou une plateforme pour insulter les religions et leur sainteté ».
** Toujours à Genève, en préparation de la Conférence de suivi de la conférence contre le racisme – dite Durban 2-, est mis à l’étude un nouveau délit de « diffamation des religions », qui heureusement ne trouvera pas d’aboutissement dans la déclaration finale. Mais pour l’OCI ce n’est que partie remise puisqu’un Comité ad-hoc pour l’élaboration de normes complémentaires en matière de racisme est au travail afin de créer de nouvelles normes internationales visant à condamner « la diffamation des religions », et non plus le racisme touchant une personne à raison de sa religion…
**Au cours de sa septième session, et sur proposition de l’OCI, le Conseil des droits de l’homme a modifié le mandat du Rapporteur spécial sur la liberté d’opinion et d’expression, en le chargeant de traquer la diffamation des religions et de limiter les libertés de la presse.
** Enfin, plus proche de nous : dans quelques semaines, en juin, le Conseil des droits de l’homme renouvellera une partie de ses 47 membres. L’Iran a annoncé qu’il sera candidat. Ce pays ne cache pas qu’il est temps de réécrire la Déclaration universelle. En avril 2009, du haut de la tribune de la conférence sur le racisme « Durban 2 », le président Mahmoud Ahmadinejad annonçait l’avènement d’une ère nouvelle aux Nations unies en lançant : « Le monde est entré dans des changements fondamentaux », « ce monde inéquitable et injuste qui arrive au bout de sa route », pour laisser la place à la victoire « d’un système mondial tel que promis par Dieu et ses Messagers ». Le président iranien propose comme solution d’avenir, la « nécessaire référence aux valeurs divine et humaine », pour un « nouveau monde décent » fondé sur l’amour, la fraternité et la soumission à Dieu, qui donnera naissance à « l’homme parfait ». L’OCI – groupe régional de 57 Etats musulmans, qui est le seul rassemblement confessionnel aux Nations unies – pourra alors s’atteler à la réécriture de la DUDH, au nom de ce relativisme religieux.
video + photo
- 13 mars 2010- Interview RFI
Invité de Véronique Gaymard, Gérard Fellous présente son ouvrage.
Insérer la bande audio
- 17 avril 2010- Fréquence protestante
Les droits de l’homme dans le Midi-Magazine
de Claudine Castelnau, sur la radio Fréquence protestante.
Insérer l’audio.
- 10 septembre 2010- Bulletin du CRIF
La Newsletter en ligne du CRIF
a interrogé Gérard Fellous en septembre 2010
à la suite de la parution de son ouvrage
*Que reste-t-il aujourd’hui de l’héritage de René Cassin ?
*Le principal héritage de Cassin, celui de l’affirmation de l’universalité des droits de l’homme, introduite dans la Déclaration de 1948, est en effet à nouveau menacée aujourd’hui. Cassin avait connu une situation semblable lorsque cette universalité fut contestée par l’URSS et le monde communiste, qui finalement implosèrent. Aujourd’hui c’est la Chine, ou l’Iran qui, au nom du relativisme culturel ou religieux, tentent de provoquer un choc Nord-Sud et de réécrire la DUDH à l’aune du particularisme culturel ou de la Chariaa. La démarche est finalement la même, celle de masquer les violations dont ces pays sont les auteurs.
Mais l’héritage de René Cassin est solidement ancré dans le droit international. Celui-ci s’est enrichi, en 60 ans, de plus de 80 déclarations ou traités relatifs aux droits de l’homme (pactes, instruments généraux ou spécifiques…), de nombreuses conventions régionales, une multitude de lois nationales et de dispositions constitutionnelles, formant un système global juridiquement contraignants.
*Que faire pour lutter contre la menace sur les droits de l’homme ?
*L’œuvre de René Cassin et l’édifice juridique international qui a été construit doivent être protégés et défendus, contre les coups de butoirs des dictatures et des théocraties qui les menacent chaque jour. Le combat pour les droits de l’homme ne sera achevé que lorsque la Démocratie s’installera dans tous les pays du globe. C’est donc à une vigilance constante, celle de la société civile, des ONG, des intellectuels, des experts, des acteurs politiques, qu’il faut appeler, particulièrement dans les forums des Nations unies. Ces combats pacifiques méritent que l’on s’y engage résolument, pour ne pas laisser le terrain libre aux violateurs de toutes natures. Des « associations René Cassin » devraient être créées, et obtenir leur accréditation dans les instances multilatérales des droits de l’homme.
*Israël sera-t-il toujours un bouc émissaire ?
*La multitude de résolutions onusiennes condamnant Israël est l’illustration même des tentatives constantes d’instrumentaliser les droits de l’homme à des fins politiques. L’objectif est de délégitimer l’Etat d’Israël, créé par une volonté de la communauté internationale, de le marginaliser afin de justifier le terrorisme, les attaques contre les civils, les guerres menées contre lui. La première phase pour détruite Israël est de l’écarter de la famille des Nations. Le combat pour la survie d’Israël n’est pas seulement mené avec les armes, il doit être également entrepris dans les instances internationales, avec le droit multilatéral, et non pas par la « politique de la chaise vide ».
*Avec le recul, quelles leçons tirez-vous de Durban II ?
* La conférence d’examen sur le racisme, dite Durban II (Genève ; 20-24 avril 2009) en est une illustration. Les pays occidentaux, un certain nombre de pays sud-américains, asiatiques et africains, se sont spontanément regroupés pour dire « non » aux diatribes de Mahmoud Ahmadinejad, pour empêcher- en dernière minute- l’Organisation de la conférence islamique de qualifier Israël d’Etat raciste et prôner sa destruction. Si la résolution finale a pu ainsi être acceptable, le danger peut revenir aujourd’hui ou demain face à de nouvelles tentatives des revanchards. Il ne faut pas déserter le terrain. Il faut se préparer à de nouveaux combats diplomatiques dans les instances internationales. Ainsi, les ennemis d’Israël n’auront pas le dernier mot.
- Mars 2006- Livre I.N. des droits de l’homme.
Les Institutions nationales des droits de l’homme
Acteurs de troisième type.
+ Photo couverture+ Note de l’éditeur
SOMMAIRE
Préface de Mme. Louise Arbour, Haut commissaire aux droits de l’homme de l’ONU
Introduction
PREMIERE PARTIE : Que sont les Institutions nationales ?
Chapitre 1 :
Les caractéristiques des Institutions nationales.
– Les Principes de Paris
– Les différents types d’appellation.
Chapitre 2 :
Les coopérations avec les autres partenaires nationaux
-Dialogue avec les Etats et les pouvoirs publics
-Coopération avec le Parlement.
-Liens avec le pouvoir judiciaire.
-Ouverture au public et aux médias.
-Relations privilégiées avec les ONG.
DEUXIEME PARTIE : La présence internationale des Institutions nationales
Chapitre 3 :
Dans le système des Nations unies
- Un concept né en 1946 à l’ECOSOC.
-Un statut dans les conférences mondiales de l’ONU.
-Une participation évolutive à la Commission des droits de l’homme.
-Un rôle dans les Comités conventionnels et procédures spéciales
Chapitre 4 :
Dans les résolutions et rapports des Nations unies
-L’onction de l’Assemblée générale.
-Les rapports du Secrétaire général.
-Partenariat privilégié avec le Haut commissariat aux droits de l’homme.
-A la recherche d’un futur statut stable.
Chapitre 5 :
Dans les Organismes régionaux :
-Conseil de l’Europe.
-Union européenne
-OSCE.
-Organisation de l’unité africaine.
-Ligue arabe.
-ASEAN Asie/pacifique
-Organisation des Etats américains.
TROISIEME PARTIE : Fonctionnement en réseaux internationaux.
Chapitre 6 :
Le réseau mondial
- Les conférences internationales
-Coordination des réseaux : Le CIC.
Chapitre 7
Les prises de positions communes sur des thématiques
- Les droits de l’homme universels et indivisibles ; -Les droits économiques, sociaux et culturels ; -Les migrants ; -La lutte contre le terrorisme et les droits de l’homme ; -La lutte contre le racisme et les discriminations ; -Les droits des personnes handicapées ; -Les droits des femmes ; -Les droits des enfants ; -Les détentions arbitraires ; -La torture ; -Les peuples indigènes et autochtones.
Chapitre 8 :
Les réseaux régionaux et sous-régionaux
-Afrique
-Méditerranée.
-Amériques et Caraïbes
- Asie/Pacifique
-Région arabe
- Europe
Regroupements : -Commonwealth
- Francophonie
Chapitre 9 :
Regards critiques et suggestions.
Conclusions
Postface de M. Joël Thoraval, Président de la CNCDH
ANNEXES : 1- Liste des Institutions nationales dans le monde.
2- Résolution de l’Assemblée générale de 1993 : Les Principes de Paris
3- Chronologie synthétique des réunions des Institutions nationales
4- Bibliographie et sources documentaires.
Préface
Madame Louise Arbour
Haut-commissaire des Nations unies pour les droits de l’homme
Les Institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme ont fait l’objet d’attention, sous une forme ou une autre, depuis 1946. La présente publication est une contribution à la littérature croissante portant sur les Institutions nationales des droits de l’homme, qui se situe à la fois dans une perspective historique, et aussi très personnelle. Elle guide le lecteur à travers le développement du concept d’Institution nationale depuis l’époque de René Cassin jusqu’à sa mise en œuvre effective de nos jours, en tant que pont dans la promotion et la protection des droits de l’homme entre gouvernement et société civile.
Le cadre international des droits de l’homme s’est considérablement développé, et il est aujourd’hui effectivement très solide. Ce qui toutefois demeure sujet à caution est la mise en œuvre de ces normes à l’échelle nationale. Bien que cette tâche reste de la responsabilité des Etats, les Institutions nationales ont à cet égard un rôle important de soutien, de conseil et de contrôle à jouer. Ce n’est pas sans raison qu’elles sont souvent considérées comme une passerelle entre la société civile et les gouvernements. A travers leurs compétences multiples, elles sont en mesure d’accroître, au niveau national, la connaissance des droits des personnes. Ceci permet ainsi tant aux femmes qu’aux hommes d’exercer leurs droits et par conséquent d’en bénéficier.
Il existe des formes diverses d’Institutions nationales des droits de l’homme répondant aux besoins spécifiques de chaque société. Cependant, ce qui est important est que les « Principes de Parsis », élaborés au fil des années et adoptés à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations unies, soient respectés. Ce ne sont pas des normes impossibles à atteindre, mais plutôt des conditions nécessaires pour qu’une Institution nationale soit crédible et efficace. Parmi ces critères figurent l’indépendance de l’Institution qui doit être établie sur une base légale solide, constitutionnelle ou législative ;l’existence d’un mandat étendu lui permettant de se consacrer à la promotion et à la protection de tous les droits, qu’ils soient économiques, sociaux, culturels, civils ou politiques ; la nécessité du pluralisme et d’une coopération étendue à un large éventail de personnes et de groupes, y compris à la société civile, et enfin, des ressources adéquates pour mener à bien ses missions.
Ainsi que cette publication le démontre, du fait de l’action que les Institutions nationales mènent au plan national et de l’impact réel qu’elles ont dans la jouissance de ces droits, la communauté internationale a reconnu favorablement leur rôle tant sur le plan régional qu’international. Elles sont perçues comme un élément fondamental dans la mise en œuvre des recommandations émises par les organes de surveillance de l’application des traités relatifs aux droits de l’homme et par les différents mécanismes établis par la Commission des droits de l’homme. Alors que les Nations unies envisagent de réformer et de renforcer la structure internationale des droits de l’homme, les Institutions nationales auront besoin d’y trouver leur propre place légitime et indépendante. Au niveau régional, nous les voyons s’engager dans le développement de mécanismes spécifiques, et travailler avec la société civile afin d’analyser les tendances et de trouver des solutions aux problèmes relatifs aux droits humains.
Ce livre Les Institutions nationales des droits de l’homme : Acteurs de troisième type est le bienvenu. J’encourage par conséquent tous ceux qui sont intéressés par la protection des droits de l’homme à lire cet important ouvrage afin que nous puissions tirer avantage, de la façon la plus pertinente possible, des Institutions nationales des droits de l’homme et de nous assurer qu’elles puissent réaliser leurs réelles possibilités.
Louise Arbour
Haut-commissaire des Nations unies pour les droits de l’homme.
- Décembre 1988- Livre Blanc sur les droits de l’homme
Sommaire
|
Jean PIERRE-BLOCH |
Préface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
13 |
| Gérard FELLOUS | Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
Jean-Marie DOMENACH
VERCORS Elie WIESEL Georges MOREL
Emmanuel LÉVINAS Alain TOURAINE
Luc FERRY
Evelyne SULLEROT France QUÉRÉ Jeanne HERSCH
Jean-Louis SCHLEGEL Jean-Marie AUBERT Pierre TOULAT
Louis-Edmond PETTITI
Abbas BENCHEIKH
EL HOCINE
Chapitre I
L’ÊTRE HUMAIN
Interrogations……………………………………………………… 21
Une notion fragile……………………………………………… 25
Réflexions sur la liberté humaine………. 29
Les Droits de l’homme en question………………….. 33
Les droits de l’autre homme…………. 43
A travers la reconnaissance de l’Autre…… 47
Politique de l’entendement et politique de
la raison……………………………………………………………… 55
Droit de… Devoir de… Désir de………………………….. 61
Entre l’intolérable et l’inqualifiable……… 69
Les fondements des Droits de l’homme
dans la conscience individuelle…………………………. 79
Chapitre II
LA TRANSCENDANCE
Les religions devant les Droits de l’homme 89 Droits de l’homme et communauté humaine 97 Un message des Églises en France………………………………………………………….. 105
Liberté de religion et de convictions……………….. 119
Les Droits de l’homme en Islam…………………….. 129
Anne-Marie FRANCHI
Droits de l’homme – Droit humain
137
|
Chapitre III
LA NATION ET L’ÉTAT |
||
| Alfred GROSSER | Droits de l’homme et politique des États | 151 |
| Albert MEMMI | L’égali é des Droits de l’homme et l’illusion républicaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
159 |
| Michel HANNOUN | Droits de l’homme et solidarité . . . . . . . . . . | 161 |
| Jean-François LAMBERT Pierre RENAULT- | ||
| SABLONNIÈRE | Droits de l’homme et démocratie . . . . . . . . . | 167 |
| Jean RIVERO | Une éthique fondée sur Je respect de !’Autre | 179 |
| Dominique TURPIN | La protection par le contrôle de constitu tionnalité des lois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
183 |
| Gérard ISRAËL | Esquisse pour une politique des Droits de l’homme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
193 |
| Marc AGI | La dimension culturelle des libertés . . . . . . | 201 |
| Chapitre IV
DROITS SPÉCIFIQUES |
||
| Jean FERNAND-LAURENT | Les Droits de l’homme, fondement de toute éthique, de toute idéologie . … . . . . . . . . . . . |
213 |
| Joseph WRÉSINSKI | Les plus pauvres, révélateurs de l’indivisi-
bilité des Droits de l’homme . . . . . . . . . . . . |
221 |
| Guy AURENCHE | Abolir la torture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 239 |
| François de FONTETTE | Le racisme et les Droits de l’homme . . . . . . | 247 |
| Pierre-André TAGUIEFF | Racismes : une interrogation critique . . . . . | 253 |
| France GUBLIN | Le droit à J’enfance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 279 |
| Michel TIBON-CORNILLOT | Respect éthique et instrumentalisation des corps en biologie et en médecine . . . . . . . . . |
281 |
| René FRYDMAN | Incidences scientifiques des progrès biologi- ques et médicaux sur le droit des personnes. |
313 |
| Michelle GOBERT | Incidences juridiques des progrès biologiques et médicaux sur Je droit des personnes . . . . . |
317 |
| Jean-François SIX | Droits de l’homme et médiation . . . . . . . . . . | 333 |
Gérard FELLOUS I. La Commission nationale consultative
des droits de l’homme……………………………………… 341
- Historique……………………………………………………. 341
- Les Commissions des droits de l’homme
dans le monde………………………………………………….. 342
- Le rôle de la Commission………………………….. 344
- Composition……………………………………………….. 346
II. Les travaux………………………………………………… 348
- Problèmes internationaux : avis et tra-
vaux…………………………………………………………………. 348
- Problèmes internes : avis et travaux . . . 353
ANNEXES
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) 373
Déclaration universelle des droits de l’hom-
me (1948)…………………………………………………………. 375
Liste des intervenants
Marc Agi Jean-Marie Aubert
Guy Aurenche
Abbas Bencheikh El Hocine Jean-Marie Domenach
Gérard Fellous
Jean Fernand-Laurent
Luc Ferry François de Fontette Anne-Marie Franchi René Frydman Michelle Gobert
Alfred Grosser France Gublin Michel Hannoun Jeanne Hersch
Gérard Israël Jean-François Lambert
Emmanuel Lévinas
Albert Memmi Georges Morel
Conseiller culturel.
Professeur des Universités émérite. Membre de
l’Académie pontificale romaine de théologie.
Avocat à la Cour. Président de la Fédération nationale de l’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture).
Recteur de l’Institut musulman de la Mosquée de Paris.
Professeur à l’école polytechnique. Ancien directeur de Esprit.
Secrétaire général de la Commission nationale
consultative des droits de l’homme.
Ambassadeur de France.
Professeur à l’université de Lyon.
Professeur de droit -Paris II.
Fédération française du droit humain.
Professeur de médecine. Hôpital Béclère-Clamart.
Professeur à l’université de droit, d1économie et de
sciences sociales de Paris II.
Professeur des Universités à l’Institut d’études po litiques.
Présidente de l’association Enfance et Partage et de la fédération La Voix de !’Enfant.
Ancien député. Conseiller général de Voiron. Maire de Voreppe.
Professeur de philosophie à l’Université de Genève. Ancien directeur du département de phi losophie à !’Unesco.
Ancien député européen. Conseiller du président de !’Alliance israélite universelle.
Société internationale des droits de l’homme. Philosophe.
Professeur émérite à l’université de Paris X.
Droits de l’homme et solidarité.
–·-··-·····–····
Louis-Edmond Pettiti Jean Pierre-Bloch
France Quéré
Jean Rivero Jean-Louis Schlegel Jean-François Six Évelyne Sullerot
Pierre-André Taguieff Michel Tibon-Cornillot
Pierre Toulat Alain Touraine Dominique Turpin
Vercors Élie Wiesel Joseph Wrésinski
Ancien bâtonnier. Juge à la Cour européenne des
droits de l’homme. Association Libre Justice.
Ancien ministre. Président de la Commission nationale consultative des droits de l’homme. Pré sident de la LICRA.
Théologienne protestante. Membre du Comité consultatif national d1éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
Professeur émérite à l’université de droit, d’écono
mie et de sciences sociales de Paris II.
Membre du conseil de rédaction Esprit. Conseil ler littéraire au Seuil.
Présîdent de l’association Droits de l’homme et
solidarité.
Sociologue. Membre du Conseil économique et so·
cial
Philosophe. Politologue.
Chercheur à !’École des hautes études en sciences sociales.
Secrétaire de la commission française Justice et
Paix.
Directeur du Centre d’analyse et d’intervention sociologiques (CNRS).
Professeur à l’Université de Clermont-Ferrand I. Président de l’Institut francais de droit humani taire et des droits de l’homme.
Écrivain.
Prix Nobel. Professeur à l’Urùversité de Boston.
Fondateur du mouvement international ATD
Quart Monde.
Préface
|
u fil des siècles, la défense des Droits de l’homme fut une conquête quotidienne, un effort continu face aux dérapages et aux bégaiements de
]’Histoire, une adaptation incessante au concept philosophique en évolution de l’Homme et de ses droits; un réajustement face à un contexte politique et à une réalité sociologique en perpétuelles transformations.
La Commission nationale consultative des droits de l’homme, unique dans le monde par sa composition et son champ de compétence, s’est appuyée dans ses travaux sur les deux piliers fondamentaux que sont la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. En réunissant des hommes et des femmes d’action et de réflexion, pour une triple mission d’information, de réflexion et d’avis aux gouvernements sur toutes les questions impliquant les Droits de l’homme, la Commission nationale consultative des droits de l’homme a transcendé les clivages politiques et idéologiques pour répondre à la haute idée que la France se fait des Droits de l’homme.
Deux années durant, en 1987 et 1988, la Commission s’est saisie d’une soixantaine de questions relevant des Droits de l’homme en France et dans le mande, soumettant ses avis et recommandations aux différents gouvernements avec le souci exaltant d’éclairer du point de vue des Droits de l’homme l’action
politique de notre pays. Il est bien vite apparu au cours de ces travaux intenses,
dont on trouvera un aperçu dans cet ouvrage, que nous étions sans cesse
ramenés à une réflexion fondamentale sur les Droits de l’homme. La nécessité s’est imposée de parvenir à un consensus portant sur un nouvel équilibre entre les différentes acceptions universelles des Droits de l’homme et sur les nouveaux champs d’application, tels qu’ils ont évolué jusqu’en 1989 et se sont élargis à de nouveaux phénomènes de société et au progrès des sciences et des techniques.
Et nos certitudes ont été fécondées par de nombreuses questions. Les quarante membres de la Commission nationale consultative des Droits de l’homme ont souhaité enrichir leurs réflexions par celles de personnalités de qualité, qualifiées, qui ont bien voulu répondre à leur invitation. II en est résulté un débat non directif dans lequel chacune et chacun s’exprime en des textes originaux, en toute liberté et sous sa seule responsabilité. Cette recherche montre? pour le moins, qu’il n’existe pas de catéchisme ou de dogme of1iciel. Les Droits de l’homme sont affaire de tous et de chacun, autour de principes universels intangibles.
Nous ancrer fermement dans une tradition humaniste, faire progresser les Droits de l’homme dans le double impératif de la réflexion et de l’action, telle est la contribution que ce «Livre Blanc» voudrait apporter au bicentenaire de la Révolution -française et de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. A la veille du troisième millénaire, il est du devoir de la ‘France de renouveler son message et de dire que la liberté de l’Homme et la démocratie seront les grands enjeux de l’avenir.
Jean PIERRE-BLOCH
Adresse : Gérard FELLOUS
Nous voulons tout d’abord saluer nos ainés, ceux qui, dans l’enthousiasme, il y- a deux siècles, ont travaillé à faire germer et surgir la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, cette Déclaration que le jeune Hegel saluera comme « un merveilleux lever de soleil », cette Déclaration dont les maximes fulgurantes embraseront tant d’esprits et de cœurs.
Pour nous, Commission nationale consultative des droits de l’homme, aujourd’hui, en 1989, quel est le désir qui nous a poussés à susciter les textes de ce « Livre Blanc >> ?
Il y a eu d1abord en nous une réaction instinctive devant l’inflation, souvent constatée, dont les Droits de l’homme font l’objet aujourd’hui. Nous avons été fréquemment agacés de les voir invoqués à tort et à travers et nous avons voulu parler, en leur fond, des Droits de l’homme, récusant ainsi par avance les multiples travestissements qu’on leur fait subir en appelant « droits l• ce qui n’est guère que caprices individuels.
Nous avons aussi voulu parler en limitant notre propos ; il n’est pas question, ici, de vouloir donner de nouveaux droits de l’homme, de prétendre apporter à nos contemporains une Déclaration qui serait à la hauteur de celle du 26 août 1789 ou la dirait même caduque ; d’autres peuvent s’y essayer. Pour nous, la question et la formulation même des Droits de l’homme ne sont pas achevés ; si la dignité de l’homme est permanente, les Droits de l’homme sont en perpétuel devenir et ils sont l’heureux objet de confrontations, de recherches diversifiées, comme ce fut toujours le cas entre membres de la Commission nationale consultative des droits de l’homme. Des événements feront peut-être naître un jour, en France ou ailleurs, une autre Déclaration, aussi intense que celle de 1789. Notre projet s’inscrit premièrement dans la fidélité à cette Déclaration fondatrice de 1789. L’ensemble de ces textes n’est pourtant pas une simple célébration du 26 août 1789, une sorte de «tombeau » comme on disait au XVIII’ siècle, c’est-à-dire un hommage rendu à un disparu. Appuyés sur nos aînés, c’est vers l’avenir, un avenir à mieux construire, que nous voulons regarder.
Notre désir est, en effet, de coopérer à ce que les Droits de l’homme, les principes de la Déclaration de 1789 -et ceux de la Déclaration de 1948 qui lui est liée – soient de plus en plus réalisés dans le monde de 1989, à J’approche du troisième millénaire. Une Déclaration des droits de l’homme qui demeurerait parole en l’air ne serait que dérision et les jeunes générations se détourneraient bientôt de ce en quoi elles ont mis tant d’espoir, depuis une décennie surtout. Il s’agit que la Déclaration ne soit pas lettre morte, il s’agit de passer à l’acte.
Oui, nous faisons ensemble, membres de 1a Commission nationale consul tative des droits de l’homme et tous les signataires de ces textes, nous faisons profession de foi ardente envers les Droits de l’homme – c’est cette foi qui préside à nos rencontres et à nos travaux. Mais nous sommes engagés à mettre en œuvre cette foi, à la rendre opérante et efficace dans notre monde aujour d’hui.
Ainsi, les textes ici rassemblés ne sont pas des écrits de stratèges en chambre ; ils sont issus de combats de première ligne, marqués par les terrains mêmes où les Droits de l’homme sont mis en cause ou rejetés. Les auteurs de ces textes ne sont pas hommes et femmes à se payer de mots. la rhétorique ne les intéresse guère ; ils expriment ici leur conviction essentielle et leur reeherche d’une adéquation la plus exacte possible entre leur profession de foi et leurs actes ; ces textes veulent être instruments pour qu’existent mieux, concrètement, les Droits de l’homme.
Chacun exprime ici, àsa manière, une conviction commune : que chaque ètre humain puisse exister en dignité, que la personne humaine sont reconnue comme un absolu, qu’aucun être humain ne puisse avoir de droits sur un autre homme, mais qu’ils soient l’un devant l’autre en égalité de droit et par là-même de devoir. C’est ainsi qu’on peut saisir ces textes dans leur unité, comme un accord fait de notes différentes, comme un diamant de lumière composé de multiples facettes. Unité à partir du respect intraitable de tout homme et de tous les hommes, à partîr d’une mobilisation radicale contre toutes les formes de discrimination, que ce11e-ci soit une prison, un haillon ou la faim.
Cette concertation, entre nous, en cette aspiration profonde, nous sommes certains que beaucoup la partagent, qu’un désir s’étend de plus en pJus, immense, de voir les êtres de cette planète se reconnaître entre eux, de voir chacun sortir de lui-même, acquiescer aux droits d’autrui, se dépasser vers l’autre, de voir chacun construire sa personnalité en même temps qu’il s1ouvre à l’autre, de voir chaque peuple reconnaitre tous les autres peuples.
Désir fou, dira-t-on. Et c’est vrai qu’on est loin du compte si l’on regarde tout autour l’amoncellement des mépris et des coercitions qui écrasent des hommes. II est donc urgent d’entreprendre et d’avancer. Nous y poussent ceux qui n’ont pas cessé d’espérer et de combattre ; et on constatera que les textes de ce recueil sont manifestement traversés par une mémoire sans cesse présente : le souvenir, le rappel que les Droits de l’homme se sont tout particulièren1ent incarnés dans des corps qu’on a meurtris, qu’ils sont faits de la chair et du sang de témoins qui sont morts pour que l’homme survive en sa liberté et sa dignité.
Comment cette mémoire ne serait-el1e pas juste invitation à être aujour d’hui des hommes ardemment responsables ? Comment ne serait-elle pas incita tion constante à déceler partout les forces et les formes de domination qui, à mesure même où notre monde cherche à devenir un tout harmonieux, cherchent, elles, à déstabiliser la dignité, à établir leurs divisions et leur emprise totali taire?
Et si, dès lors, l’on nous demande de quel droit nous pouvons affirmer une Déclaration universelle, nous pouvons répondre aussitôt que la menace est là, universelle, et qu’il y a donc à y opposer une défense unîverselle des Droits de l’homme. Afin que soient évités la solution finale et l’échec définitif, afin que notre humanité, qui connaît désormais une seule histoire et un seul avenir, n’aille pas chuter en chaos et en néant.
Les textes ici rassemblés, chacun y puisera à son gré le pain, le sel dont il a besoin pour sa route. Pour nous, à qui les dédions-nous, à qui désirons nous qu’ils parviennent d’abord ?
En premier lieu, à la jeune génération et à ceux, parents, éducateurs, qui sont constamment proches d’elle, à ceux, en même temps, qui ont su se garder un cœur jeune, ceux qui n’ont pas perdu le sens du scandale, ceux qui voient et crient qu’il y a là, sous nos yeux, partout dans le monde, de l’intolérable, qu’on ne pêut accepter, avec un haussement d’épaules fataliste, le mal, qu’on ne peut pas, ce mal, à force d’habitude ou de lassitude, le trouver normal.
Au législateur aussi, de quelque pays que ce soit, dont la tâche doit être un chantier incessant) car il ne peut être question de laisser simplement les choses en l’état. Nos aînés de 1789 se sont trouvés devant une contradiction qui demeure, entre la liberté des individus et le pouvoir social ; l’antinomie est toujours à surmonter.
Il y a toujours aussi à trouver de nouveaux moyens qui permettent à la communauté démocratique de faire une place réelle à tous ceux qui, de fait, peu ou prou, en sont exclus.
Une politique des Droits de l’homme, enfin, est toujours à recommencer, une incitation pour chaque citoyen afm qu’il puisse, là où il est, dans sa ville ou sa maison, dans son entreprise ou son groupe d’appartenance, mettre mieux en pratique, au quotidien, les Droits de l’homme.
Nous adressons enfin ce texte à chacune, à chacun de nos compatriotes, désirant l’atteindre au point le plus vivant qui est en lui, ce point à la jointure de son cerveau et de son cœur, ce point de lumière en lui qui l’invite, comme le voyageur qui reconnaît dans le cîel une étoile, à s’orienter, au-delà des brumes et des malheurs de ce temps, vers un horizon nouveau de l’homme, de tout homme, de l’humanité toute entière. Et celui-là, celle-là, sent bien que ce principe universel des Droits de l’homme n’exclut aucunement la reconnaissance positive des différences, qu’il doit pour parvenir à ses fins, être mis en œuvre dans les travaux et les jours, le temporel et le contingent, qu’il doit, pour s’accomplir. passer sans cesse par la médiation de communautés particulières. Et celui-là, celle-là, sait bien que les Droits de l omme ne s’étendront que si lui-même, elle-même les accomplissent en actes simples, des actes de cohérence et de raison, des actes où l’on a honneur d’être chaque jour un homme et qui permettent au cœur de l’humanité de battre.
Tous ensemble, d’après quelle fin pouvons-nous aujourd’hui nous con duire? Qu’il n’y ait pas seulement de plus en plus d’États de droit, mais que toute la planète devienne Terre de droit, n’est-ce pas là notre but ? Et qu’il y a à agir dès maintenant, à agir comme si cette paix universelle était presque déjà là, même si nous avons difficulté à la représenter. Ce but n1en vaut·il pas la peine pour l’homme de demain, pour tout homme aujourd’hui?
Gérard FELLOUS
La Commission nationale consultative
des droits de l’homme
- 1989-2007 – Rapports annuels sur la lutte contre le racisme
Durant dix-huit ans, entre 1989 et 2006, dans ses fonctions de Secrétaire général de la CNCDH, Gérard Fellous a été le coordinateur et le rédacteur du rapport annuel sur la lutte contre le racisme et la xénophobie remis aux Premiers ministres successifs.
Insérer — couverture et 4 eme. de couverture du Rapport 1990
L’année 2005 était caractérisée par une diminution globale importante des actes à caractère raciste et antisémite portés à la connaissance des autorités. Paradoxalement, cette baisse de la violence s’accompagnait d’une augmentation jugée inquiétante du pourcentage de personnes qui s’avouaient racistes, d’une radicalisation des opinions hostiles aux étrangers et d’un essoufflement dans la mobilisation contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie. La Commission nationale consultative des droits de l’homme estime que le bilan de l’année 2006 en termes de racisme, de xénophobie et d’antisémitisme est lui plus nuancé. Elle constate ainsi la poursuite de la baisse globale des chiffres du racisme, de la xénophobie et de l’antisémitisme en France mais estime, compte tenu de l’examen des données statistiques, que le combat est loin d’être gagné, en particulier en matière d’antisémitisme. Dans un contexte toujours marqué par de fortes préoccupations économiques et sociales, elle constate par ailleurs que les immigrés et les étrangers restent souvent stigmatisés : malgré une légère décrispation des attitudes à l’égard de l’ « Autre », elle note toujours une certaine dénonciation des immigrés, soupçonnés de ne pas vouloir réellement s’intégrer à la société française. La CNCDH relève que, malgré les efforts particuliers déployés, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir ; elle invite donc les pouvoirs publics à poursuivre les efforts entamés, à renforcer les mesures de lutte et surtout à développer les actions de prévention. Elle recommande à ce titre l’affichage d’une volonté politique forte et ciblée et rappelle que la lutte contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme doit faire l’objet d’une politique spécifique et concertée.