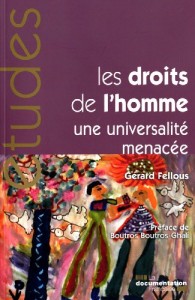Sont examinés dans cet ouvrage les menaces qui pèsent, en ce début du XXI° siècle , sur l’universalité des droits de l’homme, sachant que certaines sont bien connues depuis soixante ans et perdurent , et que d’autres sont apparues plus récemment, et semblent avoir vocation à se développer dans les prochaines décennies, si l’on n’y prend pas garde.
Est traitée plus longuement l’une de ces menaces mutantes, sur laquelle commence à se développer une réflexion sous l’identification de « relativisme culturel et religieux ». Il s’agit bien d’un « virus », au sens informatique du terme, qui risque de faire exploser l’ensemble du corpus du droit international des droits de l’homme.
Le débat n’est pas seulement théorique, il est illustré concrètement par les offensives menées, aujourd’hui et sous nos yeux, dans le système onusien des droits de l’homme, particulièrement dans les travaux du Conseil des droits de l’homme, à Genève, et dans la phase de préparation de la Conférence d’examen et de suivi de la conférence mondiale sur la lutte contre le racisme et la discrimination qui s’était tenue à Durban ( Afrique du sud) en 2001. Cette Conférence, appelée Durban-2, s’est tenue, du 20 au 24 avril, à Genève, dans un climat délétère qui ont vu se reproduire les outrances et les débordements antisémites auxquels nous avions assisté il y a huit ans à Durban, particulièrement de la part du président de la République islamique d’Iran.
Les menaces qui pèsent sur ce XXI° siècle
L’universalité à l’épreuve du « relativisme culturel et religieux ».
L’ouvrage s’arrête longuement sur ce que l’on a appelé le « relativisme culturel et religieux » qui conteste radicalement l’universalité des droits de l’homme telle que proclamée par la DUDH.
Le « relativisme culturel », concept né de l’anthropologie, a fait l’objet de longs débats depuis 1947, à partir de l’idée que toutes les cultures ont la même valeur. S’il est vrai que la culture de chaque être humain est une composante identitaire importante, enfermer symboliquement l’individu dans sa communauté est réducteur et porteur de stéréotypes racistes et liberticides. Le droit à la différence et la tolérance ne peuvent être prétextes à brimer la dignité et la liberté humaines. Les violations des droits de femmes peuvent illustrer le propos.
Il est aujourd’hui admis que les particularismes culturels ne sont recevables qu’à condition qu’ils ne portent pas atteinte à « l’égale dignité » et aux droits égaux de tous les êtres humains. L’universalisme suppose chez toute personne une essence humaine qui transcende tous les particularismes, y compris culturel ou religieux. Au postulat de l’égalité des cultures répond l’égalité et la liberté des individus. En réalité le danger est que le « droit à la différence » glisse juridiquement vers une « différence des droits ».
Autre dérive induite de la défense du relativisme culturel, l’apparition d’une thèse admettant que la dignité humaine n’est pas vécue de la même manière selon que l’on est Chinois, Indien maya ou Suisse.
Il faut également évoquer le danger que les « particularismes culturels » reconnus se dressent les uns contre les autres en une sorte de choc des civilisations. Dans un souci de conciliation, certains, comme Mireille Delmas-Marty et Gérard Cohen-Jonathan suggèrent une « conception pluraliste des droits de l’homme ». Ceux-ci seraient « conçus à partir de principes directeurs communs, appliqués avec une marge nationale d’appréciation qui reconnaitrait aux Etats une sorte de droit à la différence mais à condition de ne pas descendre au-dessous d’un certain seuil de compatibilité, qui peut d’ailleurs varier selon qu’il s’agit d’une question plus consensuelle ou plus conflictuelle ». En quelque sorte des droits de l’homme à géométrie variable, laissés à l’appréciation des pires violateurs, sans le moindre contrôle international, ce qui reviendrait à la mort de la DUDH.
Depuis un demi siècle, certains gouvernements ou instances religieuses et politiques dénient l’universalité de la Déclaration- selon les thèses dites de Singapour- au prétexte qu’elle serait l’expression de la seule culture occidentale, fondée sur la primauté de l’individu, alors que d’autres sociétés, notamment asiatiques ou africaines, accordent une valeur première à l’harmonie du groupe, et que c’est à travers la protection des droits collectifs de la communauté que se réaliseraient plus surement les droits individuels de la personne. D’autres vont plus loin en assimilant la diffusion universelle des droits de l’homme à une simple variante de l’impérialisme blanc. Ce à quoi répliquait Kofi Annan, lorsqu’il était secrétaire général des Nations unies : « il n’est pas nécessaire d’expliquer ce que signifient les droits de l’homme à une mère asiatique ou à un père africain dont le fils ou la fille a été torturé ou assassiné. Ils le savent malheureusement beaucoup mieux que nous ».
Sur la scène internationale, un type de relativisme a déjà disparu avec la disparition de l’URSS et la chute du Mur de Berlin. A la Conférence mondiale qui s’est tenue à Vienne en 1993, 171 Etats se sont solennellement engagés à respecter les droits de l’homme universellement définis, comme le commande l’article 55 de la Charte des Nations unies à tous les Etats membres. La déclaration finale de Vienne rappelait solennellement que « s’il convient de ne pas perdre de vue l’importance des particularismes nationaux et régionaux, et la diversité historique culturelle et religieuse, il est du devoir des Etats, quel qu’en soit le système politique, économique et culturel, de promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales ». On relèvera de même que c’est au nom des droits de l’homme universels que s’est faite toute la décolonisation et que l’apartheid a disparu dans le sud de l’Afrique.
Les sociétés traditionnelles, le droit coutumier peuvent-ils et doivent-ils se plier à l’universalité de la DUDH ? Certains se demandaient comment la concilier avec une « cosmovision » de la vie, de la personne des peuples indigènes.
En réponse à ces questionnements la philosophe Jeanne Hersch invoquait « l’exigence fondamentale que l’on perçoit partout » , à savoir quelque chose qui est dû à l’être humain du seul fait qu’il est un être humain : un respect, un égard, un comportement qui sauvegarde ses chances de faire de lui-même celui qu’il est capable de devenir ; la reconnaissance d’une dignité qu’il revendique parce qu’il vise consciemment un futur et que sa vie trouve là un sens dont il est prêt à payer le prix. Pour Jeanne Hersch « cette universalité là parait d’autant plus importante que l’extrême diversité des modes d’expression en garantit l’authenticité ». Ou, selon la formule de René Cassin : « Il y a quelque chose dans chaque homme qui est universel ».
Il n’y aurait donc pas, en principe, d’exception culturelle pour la garantie des droits de l’homme, sauf que, en pratique, on peut lire dans la Convention contre la torture des Nations unies de 1984, en son article 1 que le terme de torture ne « s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes ». Faudrait-il alors admettre que des peines de mutilation existant dans des traditions culturelles, pourraient être admissibles ? Les juristes en débattent encore, même si la conscience universelle s’en trouve révulsée.
Concernant plus spécifiquement le « relativisme religieux », la menace est encore plus dangereuse pour l’universalité des droits de l’homme.
De nombreux gouvernements, dans le monde musulman, invoquent les textes sacrés de l’Islam pour refuser cette universalité. Les droits fondamentaux sont alors redéfinis et réinterprétés à l’aune de la Charia. Le phénomène est récent. En effet, le 10 décembre 1948 sur les 56 Etats ayant voté la DUDH, 8 se sont abstenus, parmi lesquels un seul Etat musulman, l’Arabie saoudite, alors qu’avaient voté pour, l’Afghanistan, l’Egypte, l’Iran, l’Irak, le Pakistan et la Syrie. Mais à partir de 1966, pour les deux pactes internationaux et les différents traités -particulièrement en ce qui concerne les conventions portant sur les droits des femmes, ou sur ceux des enfants-, les pays islamiques ont introduit des « réserves » au nom de la Charia.
Le monde musulman a d’ailleurs édicté deux déclarations, concurrentes de la DUDH : une première rédigée par le Conseil Islamique pour l’Europe et adoptée en septembre 1981 sous le titre « Déclaration islamique universelle des droits de l’homme », et la seconde, bien plus importante, adoptée en aout 1990 au Caire par l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI), sous le titre « Déclaration sur les droits de l’homme en Islam ». Cette dernière proclame (dernier article 25) que « la Charia est l’unique référence pour l’explication ou l’interprétation de l’un quelconque des articles contenus dans la présente Déclaration ». Soulignons que son article 22 stipule que « tout homme a le droit d’exprimer librement son opinion pourvu qu’elle ne soit pas en contradiction avec les principes de la Charia(…) Il est prohibé d’utiliser ou d’exploiter (l’information) pour porter atteinte au sacré et à la dignité des prophètes… ».
Deux Prix Nobel viennent de dénoncer le piège du « relativisme culturel et religieux ». Pour l’iranienne Shirin Ebadi, « la plupart des Etats musulmans non démocratiques érigent l’Islam en idéologie pour justifier « la barbarie » de leur régime ». Le nigérian Wole Soyinka ajoutait pour sa part : « Le relativisme culturel prétend nous inculquer le rejet des différences, mais en fait il exige de nous d’accepter la barbarie des crimes d’honneur, la dictature, les discriminations fondées sur le sexe et la race. C’est un piège ». Le français Stéphane Hessel tente une conciliation en estimant « qu’au fond dans toutes cultures du monde, dans toutes les grandes religions et dans toutes les grandes philosophies, il y a la même conception fondamentale de la dignité de la personne humaine, et c’est la raison pour laquelle un relativisme culturel est inadmissible ».
Illustrations dans les instances des Nations unie.
Et néanmoins ce « relativisme culturel et religieux » fait sous nos yeux un très inquiétant entrisme dans les différentes instances onusiennes. Quelques exemples peuvent être cités :
L’assemblée générale de l’ONU a adopté le 9 novembre 2001 le « Programme d’action pour le dialogue entre les civilisations », proposé par le président iranien Khatami dès 1988, devant parvenir à un nouveau texte international. Le président iranien proposait alors au Secrétaire général des Nations unies : « Nous devons parvenir à une définition appropriée du terrorisme qui fait une distinction entre un acte criminel aveugle et la défense légitime contre l’occupation, la violence et la répression », en citant comme exemple « l’occupation des territoires palestiniens, la judaïsation de la Palestine, le meurtre et la terreur des civils palestiniens sans défense ». Cette initiative est lancée quelques semaines après les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis. La tentative est clairement de faire reconnaître par l’ONU un « bon terrorisme », comme celui perpétré par des « bombes humaines » qualifiées de « martyrs de l’Islam ».
Autre exemple : dès la mise en place du nouveau Conseil des droits de l’homme, en juin 2006 à Genève, on entend le ministre des affaires étrangères d’Iran, déclarer que l’une des caractéristiques de l’ère nouvelle qui s’ouvre est « l’imposition de certaines valeurs culturelles que j’appellerai uni culturalistes(…) La jouissance de la liberté d’expression ne doit pas constituer un prétexte ou une plateforme pour insulter les religions et leur sainteté ».
Cette avancée du « relativisme religieux » est par ailleurs parfaitement illustrée lors des travaux préparatoires de la Conférence de suivi de la conférence contre le racisme – dite Durban 2-, qui visent à créer un nouveau délit de « diffamation des religions », spécifiquement appelé « islamophobie », assimilé à une nouvelle forme de racisme. En corollaire, il s’agira de supprimer la liberté d’opinion et d’expression en la matière.
Le terrain était préparé par l’élaboration de nouvelles normes contre le racisme visant à condamner « la diffamation des religions », en particulier de l’Islam, dans le cadre des travaux d’un Comité ad-hoc pour l’élaboration de normes complémentaires en matière de racisme. Après plusieurs rapports, la quatrième session du Conseil des droits de l’homme adoptait en mars 2007 une première résolution présentée par le Pakistan au nom de l’OCI. Rappelons que dans son rapport sur le racisme en France, le rapporteur spécial des Nations unies estimait que le principe de laïcité est discriminatoire et raciste, soulignant que l’interdiction des signes religieux à l’école publique en France relève du racisme et de l’intolérance. Il regrette que « la laïcité ait mené à la suspicion de la croyance religieuse », considérant que l’approche « séculariste dogmatique » est utilisée pour « manipuler la liberté de religion », comme le rapportait Malka Markovich dans la revue « Les temps modernes » (juillet 2007).
Par ailleurs, le Conseil des droits de l’homme concluait sa septième session en adoptant une résolution présentée par l’OCI, modifiant le mandat du Rapporteur spécial sur la liberté d’opinion et d’expression. Celui-ci ne devra non plus prioritairement promouvoir et protéger cette liberté fondamentale, mais traquer la diffamation des religions et limiter les libertés de la presse.
Le Comité préparatoire (PrepCom) de Durban 2 a, au cours de sa session d’octobre 2008, ouvert le débat sur la diffamation des religions, en introduisant dans le projet de déclaration finale plusieurs propositions des groupes de l’OCI, des non-alignés, d’Asie et d’Afrique. La position de l’Union européenne, alors représentée par la France, était qu’il est fondamental de faire la distinction entre d’une part la critique des religions ou des convictions et d’autre part l’incitation à la haine religieuse. Seule cette dernière devrait être interdite.
L’enjeu à la conférence contre le racisme était donc bien de substituer à l’universalité et à l’indivisibilité de la DUDH, une vision différentialiste de la lutte contre le racisme. On y remplacerait, (article 18), la lutte contre toute discrimination d’une personne à raison de sa religion – par exemple le racisme antimusulman-, par la condamnation d’une parole critique contre une religion globalement désignée – par exemple l’islamophobie- . Par amalgame, il s’agira alors de définir l’antisémitisme comme étant une forme de « diffamation envers une religion ».
La France et l’Union européenne n’étaient pas prêtes à accepter une telle dérive. Consultée par la Haut-commissaire aux droit de l’homme sur la mise en œuvre par la France de la résolution du Conseil des droits de l’homme du 27 mars 2008 sur « la lutte contre la diffamation des religions », la Commission nationale consultative des droits de l’homme a estimé qu’il ne «serait ni utile, ni souhaitable d’adopter des dispositions plus contraignantes et plus répressives quant à la liberté d’expression ». En particulier la CNCDH considère que « le délit de blasphème, qui est étranger au droit français depuis près de deux siècles, ne devrait pas être introduit dans des textes, qu’ils soient nationaux ou internationaux ». Elle estime enfin « qu’il n’est pas nécessaire d’adopter de mesures spécifiques pour répondre à (cette) résolution du Conseil des droits de l’homme, sans courir le risque de mettre en cause l’équilibre existant entre la liberté de conscience, y compris la liberté de religion, la liberté d’expression, le pluralisme religieux et la paix civile dans une société laïque ».
Ces dangers ont été écartés in extremis à la Conférence de Genève sur le racisme, grâce à la pression des pays dits occidentaux, mais le débat n’est pas clos. Il rebondira bientôt.
Certaines menaces perdurent depuis soixante ans. J’en traiterai de quelques unes :
Tout d’abord ce que Mme. Louise Arbour a appelé le « schisme de la Guerre
froide » : il ne s’agit pas d’idéologie, mais d’un schisme juridique qui, dans le cadre des neuf grands traités internationaux qui ont offert un fondement contractuel et contraignant à la DUDH, a donné successivement prééminence aux droits civils et politiques, ou aux droits économiques, sociaux et culturels. Les Etats-Unis et les pays occidentaux avaient une préférence marquée pour les premiers, l’URSS autrefois, la Chine, Cuba et certains pays du Sud au sein du groupe dit des non-alignés pour les seconds. Un compromis s’est dégagé, qui n’est pas encore consolidé, selon lequel les populations peuvent plus facilement accéder aux droits économiques, sociaux et culturels, si elles ont bénéficié, concomitamment, de leurs droits civils et politiques.
n Le refus de ce que certains Etats, généralement dictatoriaux ou autoritaires,
appellent une « ingérence internationale dans les affaires intérieures ». Cette menace qui pèse sur les victimes des violations des droits de l’homme est née avec la DUDH et n’a toujours pas disparue, aujourd’hui par exemple à propos du Tibet.
Eleanor Roosevelt et René Cassin, à la tête de la commission chargée de rédiger le projet de texte, savaient bien que le point d’achoppement était celui de la « non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats », par ailleurs au fondement du système des Nations unies naissant. Face aux premières protestations contre la persécution des juifs, Goebbels répondait « Charbonnier est maître chez soi ».
La DUDH a établi un droit de regard, voire d’ingérence de la Communauté internationale en cas de violation des libertés. Il est battu en brèche par une forme de « réal politik » qui préfère fermer les yeux face à des Etats violateurs, en échange d’avantages diplomatiques ou économiques.
On sait, depuis soixante ans, que la pauvreté est à la fois la cause et la
conséquence des violations des droits de l’homme, et que la DUDH a plus de mal à être mise en œuvre dans les pays du sud.
Pour certains, comme Mireille Delmas-Marty, « à l’heure de la mondialisation économique, l’universalité des droits de l’homme est plus que jamais à l’ordre du jour. Elle montre la voie, si l’on veut éviter une mondialisation hégémonique, pour inventer un droit commun réellement pluraliste » Fait aggravant, la crise financière qui se répand – y compris dans les pays émergeants- fait que les plus pauvres et les plus fragiles se retrouvent dans une situation pire que celle qu’ils connaissaient jusque là. La Haut-commissaire aux droits de l’homme a appelé à une vigilance accrue dans les mois à venir pour assurer que les programmes de développement et les filets de sécurité soient maintenus et renforcés, afin que les effets économiques et sociaux de la crise ne deviennent pas calamiteux.
Il faut noter par ailleurs que certains profitent pour séparer, et parfois opposer, les instruments dits « régionaux » de protection des droits de l’homme, au nom d’un « relativisme géographique ».
La Déclaration de 1948 ne pouvait imaginer les progrès techniques et
scientifiques qui ont marqué la fin du XXe. Siècle et qui se développeront, mettant à l’épreuve la dignité humaine et les libertés fondamentales de manière inégale à travers le monde. Qu’il s’agisse par exemple du patrimoine génétique, de la reproduction assistée, de la fin de vie, du développement de la communication par les moyens électroniques ou des dégradations de l’environnement, la mise en conformité avec les droits de l’homme doit être universelle.
Bien qu’aujourd’hui les principes formulés par la DUDH soient repris et intégrés dans les constitutions et les lois de plus de 90 pays, que des mécanismes internationaux, régionaux et nationaux de promotion et de protection des droits de l’homme aient été mis en place, la majorité de la population de la planète ignore toujours qu’elle a des droits exigibles. Le préambule de la Déclaration de 1948 souligne que « la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révolte la conscience de l’humanité », reprenant du reste la formulation de la Déclaration française de 1789 : « l’ignorance, l’oubli et le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements ». Pour tenter d’y remédier à l’avenir, la Haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Madame Navi Pillay, lançait il y a quelques jours, dans le cadre de ce 60 e. anniversaire, l’Année internationale de l’apprentissage des droits de l’homme.
Autre menace récurrente contre l’universalité de la DHDH et de ses instruments internationaux, la non-effectivité des droits de l’homme. De la proclamation à la mise en œuvre effective il y a trop souvent un fossé, y compris dans nos pays démocratiques.
On y ajoutera les effets pervers et plus subtils des « réserves » apportées par de nombreux Etats. Ceux-ci donnent l’impression de jouer le jeu en ratifiant un texte international, mais ils utilisent de façon abusive la technique des « réserves » pour, en réalité, nationaliser le texte et revenir au traditionnel « chacun est maitre chez soi », et donc refuser l’internationalisation des normes.
Conclusion.
A la racine des valeurs fondant l’universalité des droits de l’homme, Hannah Arendt disait que c’est « l’idée d’humanité qui constitue la seule idée régulatrice en terme de droit international ».
Cette prise en compte de l’homme comme « mesure de toutes choses » trouve ses racines philosophiques dans la conscience universelle, et appartient en héritage indivis à toutes les civilisations et toutes les religions, soulignait le professeur Emmanuel Decaux. L’affirmation des droits de l’homme vaut partout et pour tous, ou elle ne vaut rien. Elle implique en effet « la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine », sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.
Ces droits innés trouvent cependant des limites, et d’abord dans le respect des droits d’autrui, voire des dérogations au nom de l’ordre public ou du devoir de vivre ensemble, sans compter d’éventuels conflits de droits. S’agit-il dès lors de « droits naturels » inviolables et sacrés, ou seulement de droits relatifs encadrés par la loi, sinon octroyés par l’Etat souverain ? Peut-on opposer le particularisme des situations et des cultures à l’universalité des valeurs ? La Déclaration universelle des droits de l’homme a répondu il y a 60 ans à ce dilemme : Avec elle, c’est le droit international positif lui-même qui consacre pleinement les droits de l’homme comme des droits égaux et inaliénables, qui doivent être protégés par un régime de droit.
La Déclaration universelle appartient à chacun des êtres humains. Elle n’appartient pas aux Etats, mais elle les oblige. Elle reste, hier comme demain, « l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations », comme l’a voulu René Cassin.
PREFACE
Boutros BOUTROS-GHALI
ancien Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
Les droits de l’Homme sont, tout à la fois, absolus et situés. C’est-à-dire qu’il faut, tout à la fois, les poser dans leur universalité et les rendre accessibles à tous, quelles que soient leur histoire, leur langue, leur culture.
Dès lors, les droits de l’Homme que nous cherchons à garantir, ne peuvent être que le résultat d’un dépassement, le produit d’un effort conscient pour retrouver notre essence commune par-delà nos clivages apparents, nos différences du moment, nos barrières idéologiques et culturelles.
Les droits de l’homme ne sont pas le plus commun dénominateur de toutes les nations, mais au contraire, ce que j’ai appelé lors de la Conférence de Vienne en 1993, « l’irréductible humain », c’est-à-dire la quintessence des valeurs par lesquelles nous affirmons, ensemble, que nous sommes une communauté humaine.
L’ouvrage de Gérard Fellous, ancien Secrétaire général de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme, est une contribution magistrale à l’étude des problèmes soulevés par la protection des droits de l’Homme. Cette étude passe en revue les différentes étapes franchies en la matière, de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 jusqu’à la Conférence de Vienne de 1993, qui a donné naissance à une nouvelle politique onusienne fondée sur l’imbrication entre droits de l’Homme et démocratie.
Le combat pour les droits de l’Homme et le combat pour la démocratie ne font qu’un. Mais il ne peut, dans le même temps, y avoir de démocratie sans une solide culture des droits de l’Homme. Car la démocratie, par plus que les droits de l’Homme, ne peuvent être l’objet d’un mimétisme conceptuel, d’un transfert institutionnel, comme on parlerait de transfert de technologie.
Les droits de l’Homme constituent, sans conteste, la meilleure des réponses possibles à la déréglementation généralisée que nous vivons. Mais ils ne peuvent demeurer un combat isolé, qui trouverait sa finalité en lui-même. Les droits de l’Homme sont devenus un tel enjeu pour l’avenir, nous avons mis en cet idéal tant d’espoirs et de rêves que nous devons dans les années qui viennent amplifier ce combat en l’élargissant résolument au combat pour la démocratie, pour le développement et pour la paix.
Le combat pour les droits de l’Homme est plus que jamais d’actualité. C’est un combat du XXIème siècle, transposé dans une perspective nouvelle. Et c’est à ce combat pour l’avenir que nous invite la lecture de l’ouvrage de Gérard Fellous.
Boutros Boutros-Ghali
Président de la Commission nationale égyptienne des droits de l’Homme
embedded by Embedded Video